 Dans je neige (entre les mots de villon) (LansKine, 2018) vous parlez de « la voix intérieure, celle qui nous habite et que souvent nous n’entendons pas, recouverte par l’usage » (page 48). Lorsque vous écrivez « La neige aussi / Nous déborde » (p. 18), ce « nous » inclut-il le lecteur ? Car, si écrire permet au poète d’entendre cette voix intérieure, qu’en est-il en effet du lecteur ? Comment accède-t-il à sa propre voix « recouverte par l’usage » ?
Dans je neige (entre les mots de villon) (LansKine, 2018) vous parlez de « la voix intérieure, celle qui nous habite et que souvent nous n’entendons pas, recouverte par l’usage » (page 48). Lorsque vous écrivez « La neige aussi / Nous déborde » (p. 18), ce « nous » inclut-il le lecteur ? Car, si écrire permet au poète d’entendre cette voix intérieure, qu’en est-il en effet du lecteur ? Comment accède-t-il à sa propre voix « recouverte par l’usage » ?
J’emploie rarement le nous sans toutefois le refuser. Ma perception du collectif est celle de singularités réunies. Il y a une tendance aujourd’hui à une « généralisation », à un nous qui serait aussi automatique et « fourre-tout » que le je l’était devenu par excès de subjectivisme. Nous avons tous conscience de vivre une période où le modèle capitaliste et consumériste occidental ruine la vie sociale et écologique mais aussi la vie des idées et des sentiments. Le recours systématique au nous de la part de poètes ne me semble pas pour autant une réponse appropriée aux attaques de l’époque, pas plus que ne le serait une écriture purement objectiviste. Même si l’usage du je a pu conduire à des excès, il est pour moi illusoire de croire qu’un nous nous mènerait à l’expression d’un collectif plus politique. On peut passer d’une forme de cucuserie sentimentaliste à la première personne du singulier, à une cucuserie pseudo-politique à la première personne du pluriel. Tout dépend de ce qu’on fait du pronom. Comme on le sait bien, il y a des nous qui masquent un je, et des je qui sont les autres voire des objets. Je suis assez proche de la position de Frank Smith notamment dans Chœurs politiques, qui envisage une collectivité et un pluriel à partir d’une multitude de singularités.
Il est important pour moi de ne pas écrire de façon désincarnée, de laisser la possibilité du je, comme ouverture vers plus que soi, sans fermer aucune des autres perspectives : ils-elles, vous, nous, tu et il ou elle. Ou encore des grammaires inventées comme jl dans kaspar de pierre une quatrième personne du singulier, le ielle que j’emploie à un moment dans les corps caverneux entre il et elle, ou encore le on qui me semble plus objectivant et prudent que le nous, sans oublier les points de vue objectifs et impersonnels qui sont à l’œuvre dans mon écriture, une manière aussi de faire entendre la polyphonie du monde et l’écart entre voix animées et inanimées.

Quand j’écris « La neige aussi / Nous déborde », il s’agit bien sûr d’une main tendue au lecteur. J’évoque la neige, seule matière commune entre l’époque de Villon et la nôtre. La langue a changé mais la neige est là, même s’il neige moins à l’époque de l’Anthropocène ! Néanmoins cette neige commune existe et ce nous existe. À ce moment-là. Il est une sorte de moment monodique. De fusion. À la différence du on qui peut désigner une pluralité discordante. Ce nous est alors un pont précaire dans le temps mais aussi, à un moment, une réduction du polyperspectivisme, une vue « commune », oui. Ce qui est parfois nécessaire mais auquel il faut avoir recours avec grande prudence. Ce jeu sur la focalisation permet au lecteur d’avoir une mobilité qui était aussi à l’œuvre dans la poésie de Villon et qui rend vigilant.

Vous dites qu’il y a plusieurs voix chez Villon. N’en est-il pas de même chez vous ? Cette polyphonie ne serait-elle pas constitutive de la singularité de toute vocation poétique ?
Dans sa poésie, Villon polyphonise le monde. La vocalité de sa poésie est complexe : elle comporte encore des schémas de poésie orale tout en étant très écrite déjà, elle est dans cette tension permanente entre oralité et scripturalité. Elle y donne voix aussi bien à des objets dépréciés qu’à des personnes qui n’apparaissaient pas dans la poésie écrite de l’époque. Quant au moi qui figure dans ses poèmes, il y est multiple, protéiforme et devient verbe commun, « villonner », et toutes les variations qu’il opère à partir de ce nom. Comme il disperse ses objets fictifs dans le Testament, Villon se dilapide, prend le nom propre pour en faire des noms communs, mais aussi avec ce commun faire du singulier. J’ai une affinité profonde avec la vocalité chez Villon même si la mienne s’architecture différemment et répond à un autre « présent ». Il y a même dans mes textes à la première personne, un éclatement de la voix, une multiplication des points de vue. Une mobilité de l’écriture vocale. Les voix ne sont pas des voix-personnages ! Il y a dans chaque texte une autre construction de la vocalité, qui recouvre une dimension visuelle, plastique, mais aussi grammaticale, ou quasi-filmique avec des voix-commentaires en off, des voix depuis le hors-champ visuel, des décentrements, des statuts de voix différents.
Il y a de multiples vocalités dans toute écriture : les fameuses « voix sous le texte ». Cela ne veut pas dire pour autant que ces voix fassent signe vers la musique ou vers du son. Parfois on réattribue aussi du lyrisme à des auteurs qui souhaitaient l’éradiquer ou jouaient la dimension plastique contre la dimension sonore. Dans le roman également, j’apprécie des écritures très polyphoniques, celle de Thomas Bernhard, de Claude Simon, de W.G. Sebald, de Josef Winkler ou encore d’Antoine Volodine par exemple, dans la poésie, je pense bien sûr à Thomas Kling, ou encore à Gherasim Luca, à Christophe Tarkos et bien d’autres encore.
 Fondamentalement, toute écriture est nécessairement liée au son et à la vision, mais toute écriture n’est pas systématiquement polyphonique. Il y a des écritures radicalement monodiques. Villon était baigné de polyphonie musicale et l’éclatement de la vocalité ne m’étonne guère chez lui, de ce point de vue aussi. Ce n’est pas un hasard si l’avènement musical de la monodie et de l’opéra (genre bourgeois par excellence) depuis 1600 jusqu’à 1900, les heures de gloire du lyrisme musical, va de pair avec un renforcement toujours plus grand au fil des siècles de la focalisation sur la subjectivité dans l’écriture poétique et romanesque. La critique objectiviste de l’épanchement au XXe siècle a eu plusieurs mérites, dont celui de faire entendre des voix autres : celles des objets de Ponge ou des documents d’archives chez Reznikoff. La musique contemporaine, elle aussi, a renouvelé son approche de la vocalité, cela va de pair, on peut capter la voix d’une pierre aujourd’hui et la transformer électroacoustiquement : dans Back into nothingness, monodrame pour une voix, chœur et électronique que j’ai réécrit à partir de kaspar de pierre, la compositrice Núria Giménez-Comas et moi avons travaillé la dimension polyphonique via le chœur, mais elle a aussi mêlé une vocalité du nuage ou de la pierre aux voix de kaspar. C’est cette tension entre une poésie sans sujet et une poésie incarnée qui permet, à mes yeux, d’appréhender les tensions du réel.
Fondamentalement, toute écriture est nécessairement liée au son et à la vision, mais toute écriture n’est pas systématiquement polyphonique. Il y a des écritures radicalement monodiques. Villon était baigné de polyphonie musicale et l’éclatement de la vocalité ne m’étonne guère chez lui, de ce point de vue aussi. Ce n’est pas un hasard si l’avènement musical de la monodie et de l’opéra (genre bourgeois par excellence) depuis 1600 jusqu’à 1900, les heures de gloire du lyrisme musical, va de pair avec un renforcement toujours plus grand au fil des siècles de la focalisation sur la subjectivité dans l’écriture poétique et romanesque. La critique objectiviste de l’épanchement au XXe siècle a eu plusieurs mérites, dont celui de faire entendre des voix autres : celles des objets de Ponge ou des documents d’archives chez Reznikoff. La musique contemporaine, elle aussi, a renouvelé son approche de la vocalité, cela va de pair, on peut capter la voix d’une pierre aujourd’hui et la transformer électroacoustiquement : dans Back into nothingness, monodrame pour une voix, chœur et électronique que j’ai réécrit à partir de kaspar de pierre, la compositrice Núria Giménez-Comas et moi avons travaillé la dimension polyphonique via le chœur, mais elle a aussi mêlé une vocalité du nuage ou de la pierre aux voix de kaspar. C’est cette tension entre une poésie sans sujet et une poésie incarnée qui permet, à mes yeux, d’appréhender les tensions du réel.
Dans la première partie de je neige (entre les mots de villon), la mise en page fait sens, autant que le texte lui-même, comme si elle avait été pensée, comme si l’agencement et la distribution sur la page des noirs, leur soudaine densité, ainsi que la répartition des blancs, faisaient partie intégrante de votre écriture. Je pense par exemple aux pages 22 et 23, et à la page 27. Lorsque vous parlez de la plasticité de la langue, pensez-vous également à la mise en page ? Est-ce que le blanc de la page fait également partie de votre écriture ?
Si j’entends l’écriture, je la vois aussi typographiquement. La typographie est un élément qui participe du son, du rythme, de la ponctuation. J’ai eu avec kaspar de pierre et je neige la chance que mes éditeurs me suivent dans cette répartition des blancs et ce partage typographique des voix. Dans marie weiss rot / marie blanc rouge, où le texte allemand et le texte français sont publiés tête-bêche, les deux « versions » se rejoignent au centre du livre sur trois pages blanches, sorte de grand fondu au blanc. Ça n’était pas simple éditorialement et ces projets se fondent sur la confiance.

J’alterne les rythmes. Je n’écris pas de poèmes « isolés » et mes livres ne sont pas des recueils de poèmes mais des livres de poésie, quelquefois des récits. Je joue sur différentes temporalités, celle du livre, de la séquence, et aussi celle de la page, alternant écriture en prose et poèmes qui surgissent à contre-rythme. Pour marquer ces alternances, un travail sur la mise en page est important, même si c’est un travail a minima.
Je n’écris pas de poèmes typographiques, l’écriture est première. Ce n’est qu’après que je pense la disposition sur la page : les tensions à l’œuvre dans le texte sont ainsi visibles. Je cherche à organiser le rythme qui est déjà celui du texte. Celui-ci en effet ne se borne pas à des répétitions, ce dont je me méfie comme effet souvent trop facile : la disposition sur la page permet de répartir les blancs et les noirs, de créer des tensions aussi entre des blocs de prose et l’émergence d’un poème, de tenir un équilibre-déséquilibre de la voix, de souligner un mouvement de dispersion, de désensevelissement à l’œuvre dans le texte.
« Pour un mot inarticulé / qui, magie blanche / s’écrit », lit-on p. 26. Vos blancs représentent-ils l’informulé ?
J’ai une obsession pour le blanc, en effet : d’un point de vue musical, plastique, poétique et filmique. Il y a une polysémie du blanc à l’œuvre dans mes textes, des tensions qui se jouent. J’aime les bruits blancs en musique mais aussi les fondus au blanc dans Effi Briest de Fassbinder. Entre autres, les vitraux blancs de Soulages.

Les blancs dans mes textes sont souvent des ponctuations, des silences quasi musicaux indiquant des longueurs, des tenues de silence. Mais ils peuvent être parfois des fondus au blanc, qui permettent d’atténuer une saturation de langue, le souvenir d’un vers s’estompe ainsi par la vue du blanc avant que l’on revienne en langue. D’autres fois, le blanc est une menace, une disparition, un effacement sonore et visuel, comme c’est le cas pour le je absent de kaspar de pierre, figuré par un espace vide. Il peut être encore un son blanc ou un silence relatif, où le lecteur n’entend plus que sa respiration, ses bruits intérieurs et plus ceux du livre. Quelquefois, un blanc, c’est l’absence de langue, la difficulté à formuler que marque un mot, il peut aussi marquer un son traumatique. Parfois, c’est tout cela à la fois, c’est au lecteur d’en faire l’épreuve.
Dans je neige (entre les mots de villon) vous parlez de « la faille de dire ». En quoi dire serait une faille ?
La faille de dire, pour moi, c’est le contraire de l’épanchement néoromantique. On peut partir d’une entaille dans une personne ou dans une situation, partir du petit bout de la lorgnette donc, mais considérer que cette entaille n’est pas le début d’un épanchement, d’une polarisation mais au contraire une ouverture vers une pensée-sensation. Ainsi, les faits divers sont-ils des entailles dans l’ordre des choses. Les fissures permettent d’apercevoir le monde de biais, de faire dérailler l’ordre des choses et d’ouvrir le champ / chant.

Je reviens sur l’importance de l’informulé, voire de l’informe, dans votre esthétique, comme si au commencement n’était pas le verbe, mais le blanc. Est-ce que votre esthétique n’est pas entièrement tendue vers une recherche quasi mystique d’un « outreblanc » ?
 Quelque chose émerge depuis le réel : quelque chose qui a un sens que je ne fais que deviner. Au départ se trouvent des sons, des images. Par ailleurs, des idées se formulent, des mots apparaissent. Une image poétique naît, me semble-t-il, de cette rencontre entre une pensée et une image-son dont le sens s’écrit. Ce sens caché qui apparaît peut avoir une dimension quasi mystique. Sans que cela aille vers un sacré néo-religieux comme chez Bataille. Mais il y a en effet une poussée vers de l’informulé. Qui s’exprime notamment mais pas seulement dans les textures et les nuances de blanc. J’aspire sans doute aussi, un peu comme la quête du monolithe dans 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick, à aller vers les confins : de la pensée, de la perception.
Quelque chose émerge depuis le réel : quelque chose qui a un sens que je ne fais que deviner. Au départ se trouvent des sons, des images. Par ailleurs, des idées se formulent, des mots apparaissent. Une image poétique naît, me semble-t-il, de cette rencontre entre une pensée et une image-son dont le sens s’écrit. Ce sens caché qui apparaît peut avoir une dimension quasi mystique. Sans que cela aille vers un sacré néo-religieux comme chez Bataille. Mais il y a en effet une poussée vers de l’informulé. Qui s’exprime notamment mais pas seulement dans les textures et les nuances de blanc. J’aspire sans doute aussi, un peu comme la quête du monolithe dans 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick, à aller vers les confins : de la pensée, de la perception.
Néanmoins, ces moments-là sont des moments d’émergence qui traversent mes textes, parcourus par ailleurs par des tensions du réel, des plus violentes aux plus incongrues. J’écris aussi depuis la basse mise, depuis le très prosaïque de notre monde. La scène de la blanquette de veau dans la cafétéria de l’Ehpad côtoie dans La cité dolente les autres irruptions « outreblanches ». Des faits divers strient les poèmes de caverne dans les corps caverneux.
Une sorte de « transréalisme » est à l’œuvre dans mes textes, c’est le nom que je donne à un nouveau rapport au réel, qui n’est ni réaliste, ni surréaliste mais une sorte de traversée du réel, une présentation du réel dans toutes ses tensions, et ses contradictions dans des temporalités variées en germe ou en sédimentation dans le temps présent. Mes textes émergent, sans doute, de ces tensions entre un réalisme et une quête quasi mystique de l’informe. Je crois que les critiques sont plus à même de le formuler que moi. Car cela ne relève pas de l’intentionnalité.

Que ce soit dans kaspar de pierre ou dans je neige (entre les mots de villon) vous utilisez le caractère gras, l’italique, la majuscule ou encore le signe mathématique =. Certains poètes ont rejeté tout cela. Je pense par exemple à Emmanuel Laugier qui explique dans un entretien publié dans Télérama [1] n’avoir plus utilisé de majuscule depuis son premier livre, ni de ponctuation, rien à part l’usage du blanc, comme scansion, ou de signes typographiques comme la barre /. Votre approche est tout autre. Est-ce à dire que selon vous rien n’est impropre à la poésie ?
Mon projet est différent de celui d’Emmanuel Laugier. Il ne s’agit pas uniquement de différences formelles, mais le sens de l’œuvre est autre. Une langue et une ponctuation doivent répondre à une nécessité interne et à un projet donné. C’est à chacun de tracer ses nécessités, ses bornes et le sens de son projet. J’écris rarement à partir de formes codifiées, mais pour un projet encore inédit (les voix serpentes), j’ai eu recours à des sextines, interrompues par de la prose, car le projet le réclamait. Si ma langue a des obsessions qui la parcourent d’un livre à l’autre, mon rapport notamment à la typographie et à la syntaxe diffère d’un livre à l’autre, souvent même d’une séquence du livre à l’autre. Dans le livre que j’écris en ce moment les corps caverneux, les majuscules en début de vers sont sporadiques et nécessaires car elles marquent des surcroîts d’accentuation. La langue allemande et la prosodie allemande sont d’une extrême importance pour moi et j’ai besoin de ces « attaques » sur-accentuées, de cette prosodie fondée sur les accents toniques, ce que marquent chez moi les majuscules. Dans la dernière séquence « désir de nuages », écrit pour part en vers, pour part en prose, le texte parle depuis des nuages, le cumulonimbus, le cumulus, le stratus, etc… La syntaxe se modifie, elle est très mobile en fonction du nuage : pour certains passages en prose, il n’y a plus du tout de ponctuation à part les majuscules-intonations et les blancs. Dans « les corpscav » certains poèmes brefs interrompent la prose, avec une ponctuation plus classique. Dans certaines séquences je respecte le point final. Dans d’autres, le poème l’abolit, les phrases, même en prose, restent ouvertes. Dans kaspar de pierre, le projet a nécessité une autre pensée et donc aussi une autre typographie. Le texte se joue davantage en vers même si le blanc est la ponctuation principale, il était important pour moi de ne pas chercher à imiter le langage de Kaspar Hauser, mais de choisir de n’écorcher la grammaire que de façon sporadique, artificielle et limitée pour éviter toute imitation de la « sauvagerie » : certains verbes sont sans terminaison, certaines consonnes redoublées, c’est tout, le reste dans une ponctuation plus « classique ». C’était important de limiter les moments d’émergence, la tension entre la norme et ce qui fait dérailler la syntaxe, des rythmes et contre-rythmes. Chaque livre repose la question, celle du sens et donc celle de la syntaxe et du rythme.

Vous dites la nécessité de lire aujourd’hui Villon. Je pense à ces mots de Koltès : « Je suis le premier à admirer Tchekhov, Shakespeare, Marivaux […]. Mais, même si notre époque ne compte pas d’auteurs de cette qualité, je pense qu’il vaut mieux jouer un auteur contemporain, avec tous ses défauts, que dix Shakespeare. » (Un hangar, à l’Ouest (notes) in Quai Ouest, Minuit, 1985) Qu’en pensez-vous ?
Il est nécessaire de lire et de relire Villon. Sa poésie se situe à un moment-seuil entre le Moyen Âge finissant et la Renaissance et nous sommes, nous, à un autre moment-seuil, aux confins de la modernité, peinant à imaginer l’après. Je crois à ce mouvement benjaminien qui consiste à trouver des germes d’à-venir dans le passé : mon retour vers le Moyen Âge poétique de Villon n’est pas une romantisation, bien au contraire, il s’agit pour moi de transformer le présent, et d’apercevoir un ailleurs, une « après modernité » que l’on peine à nommer. Pour sortir de la modernité qui a commencé au début du XIXe siècle, avec le début de l’industrialisation, l’avènement d’une société bourgeoise et aussi l’apparition du romantisme, qui abrite à la fois des tendances modernes et antimodernes, il faut relire autrement cette poésie du Moyen Âge, autrement que les Romantiques allemands ne l’ont fait, y voir des germes d’autre chose, ignorés jusqu’alors. C’est important d’entreprendre ces mouvements vers le passé, pas dans un but muséal ou idéalisant mais dans un dialogue présent avec l’avenir. Mais bien sûr, cette lecture de textes poétiques passés accompagne la lecture quotidienne de la poésie contemporaine, je suis lavée par les écritures d’aujourd’hui.
J’ai du mal à quantifier comme Koltès. Dire qu’il faudrait dix contemporains pour un ancien. Mais je comprends et partage sa douleur à voir des répertoires où très peu d’écritures contemporaines sont jouées sur scène. En France du moins, car en Allemagne par exemple, les jeunes dramaturges sont davantage joués. La France a une tendance plus muséale que les pays anglo-saxons, ce n’est pas une nouveauté. La situation de la poésie contemporaine est à la fois plus espérante et plus désespérée. Il est plus simple de lire de la poésie contemporaine que d’assister à de nouvelles pièces de théâtre : la poésie est éditée, la France comporte énormément de petites maisons d’édition de grande qualité, de bibliothèques gratuites, en cela elle est une exception en Europe. Les livres de poésie contemporaine sont certes sous-représentés en librairie mais ceux de poésie ancienne également. Le fait est que la poésie en général n’est quasiment plus lue même si cela va changer, j’en suis persuadée. Et cela touche tous les milieux. La seule chose qui permet à la poésie d’exister en ce moment ce sont les lectures, où les gens découvrent la poésie contemporaine, de vive voix, et le travail de certains enseignants, de certaines radios. Mais, dans un même temps, elle est effacée des programmes, et la dernière réforme des programmes des lycées est terrifiante de ce point de vue aussi, car elle balaie d’un revers de main tout le contemporain. Le dernier « contemporain » enseigné est Apollinaire. Ce qui est contemporain a un siècle ! C’est terrifiant pour la langue. Ne pas enseigner la littérature récente a bien sûr une incidence : elle empêche une génération de voir combien la langue poétique d’aujourd’hui est transgressive, contemporaine et émancipatrice.
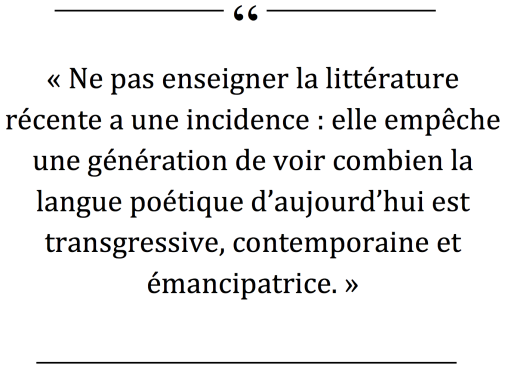
Une réflexion sur “Entretien avec Laure Gauthier (deuxième partie)”