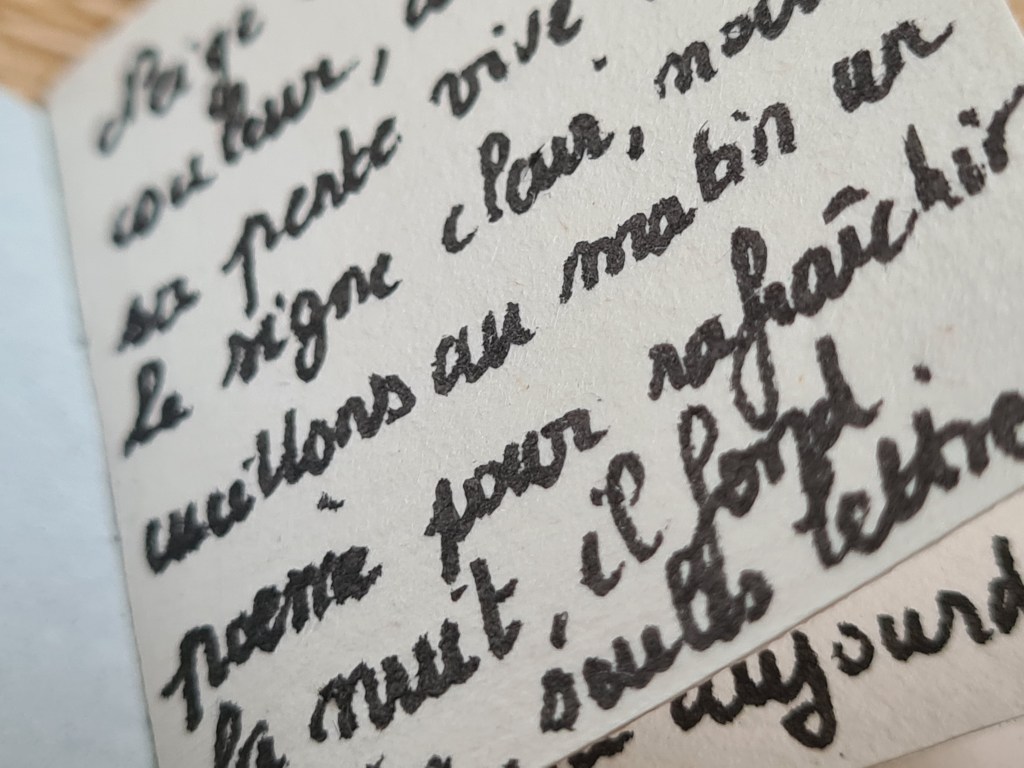
Poétesse, critique et enseignante, Isabelle Lévesque est née en 1967 aux Andelys, dans l’Eure, où elle vit toujours. Anciennement membre du comité de rédaction de la revue Diérèse, où elle a codirigé les numéros consacrés à Thierry Metz, elle collabore régulièrement à Quinzaines, ainsi qu’aux revues Europe, Terres de femmes et Terre à ciel. Ses œuvres poétiques, ainsi que ses photographies, sont tournées vers les paysages et le monde floral. Elle a publié, notamment, Ni loin ni plus jamais (Le Silence qui roule, 2018), Le Fil de givre, avec des peintures de Marie Alloy (Al Manar, 2018), Voltige !, avec des peintures de Colette Deblé (L’herbe qui tremble, 2018 — prix international de Poésie francophone Yvan-Goll), C’est le vent son secours, avec des gravures de Marie Alloy (Le Silence qui roule, 2019), Chemin des centaurées, avec des peintures de Fabrice Rebeyrolle (L’herbe qui tremble, 2019) et En découdre (L’herbe qui tremble, 2021).
Vous citez Thierry Metz en épigraphe de votre nouveau livre, En découdre : « Où se retrouver quand tout aura brûlé dans nos paroles ? » Vous le citiez déjà dans Chemin des centaurées. Vous placez également souvent en épigraphe de vos ouvrages des extraits de poèmes d’Éric Sautou. On sent toute l’importance chez vous de la voix des poètes, et de ceux-ci en particulier. Dans un entretien, vous parlez de l’auteur du Journal d’un manœuvre comme d’un « fondateur ». Diriez-vous que votre propre voix/voie poétique ne pouvait advenir sur le chemin de votre existence qu’accompagnée par ces voix amies ?
Le choix d’une épigraphe représente pour moi l’occasion d’exprimer une reconnaissance. Cela me semble aussi important que d’indiquer par un extrait comment tirer un fil des poèmes que je viens d’écrire. En ce sens, Thierry Metz est de manière absolue un poète fondateur. Lorsque je l’ai lu pour la première fois, grâce aux éditions bordelaises Pleine Page, qui n’existent plus, j’ai ressenti le besoin de lire tout ce qu’il avait écrit. Il se trouve que, peu de temps après, collaborant à la revue Diérèse dirigée par Daniel Martinez, j’ai eu l’occasion de faire la connaissance de Françoise Metz, la « Bien Aimée » des poèmes, dont je me sens toujours proche et qui m’a fait lire des inédits de Thierry Metz. Je n’ai jamais cessé de lire ce poète depuis, même si mon écriture est assez loin de la sienne. La simplicité extrême de ses poèmes et leur profondeur m’impressionnent.
Avec Daniel Martinez, nous avons constitué deux numéros spéciaux consacrés à Thierry Metz (N°52/53 en 2011 et 56 en 2012). Cela fut aussi pour moi l’occasion d’ouvrir mon activité critique puisqu’il a fallu, pour présenter les inédits, situer les textes, les commenter aussi puis peu après écrire une préface pour Carnet d’Orphée et autres poèmes (Les Deux-Siciles, 2011) et, plus récemment, pour Le Grainetier (Pierre Mainard, 2019). J’ai saisi également toutes les occasions de commenter son écriture et participé à des lectures. Il reste une étoile – l’épigraphe de mon premier texte complet constitué, Or et le jour, est de lui :
« Je me tais.
J’écoute.
Un oiseau s’est posé sur moi.
Quelqu’un dans la haie a ouvert un livre
malgré les épines. »
Thierry Metz, Terre (Opales / Pleine page, 1997)
J’ai découvert Eric Sautou plus tard en lisant Les vacances (Flammarion, 2012). Peut-être n’est-il pas très loin de Thierry Metz, d’ailleurs, par la réduction, la soustraction des mots qui s’imposent dans les poèmes : certains manquent ou disparaissent dans les voix qui les peuplent. D’autres poètes s’imposent à moi encore, Guillaume Apollinaire par exemple, dont le nom est poème déjà, je dirais qu’il a été le premier des grands poètes à m’accompagner lorsque j’étais étudiante. Je pense aussi à Jean-Philippe Salabreuil qui a nourri un livre édité par Le silence qui roule, Ni loin ni plus jamais, tant son emportement et la profusion de sa langue me fascinent. Je suis aussi une lectrice admirative de Caroline Sagot Duvauroux : génie de la langue, histoires à dormir debout, toute une vie entre dans ses poèmes et sa culture n’écarte pas les trouvailles de langue. Elle représente pour moi une forme du génie poétique. Pour Nous le temps l’oubli (L’herbe qui tremble, 2015), j’avais placé en épigraphe deux vers qui me reviennent sans cesse encore aujourd’hui :
« avec l’allégresse cependant et l’audace qui est la grâce des herbes
au bord des précipices »
Caroline Sagot Duvauroux, Aa, Journal d’un poème (Corti, 2007)
Il faudrait encore citer bien d’autres écrivains comme Samuel Beckett ou le philosophe historien de l’art Georges Didi-Huberman, le premier incitant à « finir encore », le second à « commencer encore »… Ces voix m’accompagnent, elles me tiennent debout lorsque je doute de la force de la langue, du poème. Il suffit que je revienne à l’une d’entre elles pour éprouver pleinement la force de soulèvement (dont parle si bien justement Georges Didi Huberman dans Désirer désobéir – Minuit, 2019) du poème, et c’est plus intuitif que pensé. C’est vécu aussi.
Sans doute que toutes ces épigraphes peuvent constituer une sorte d’autoportrait en mouvement de l’auteure qui les choisit…
Mais je ne saurais pas dire si c’est cela qui me fait écrire. Il me semble plutôt qu’une forme de porosité au monde nourrit le désir d’écrire et rend nécessaire cet acte. J’écris parce que j’en ai besoin. Pour vivre. Pour établir un lien entre tout ce qui arrive. Pour ne pas étouffer et aussi, beaucoup, par amour. Je distinguerais de ce point de vue l’écriture sur les poètes, l’activité critique, que j’aime mais dont je n’ai pas besoin, et celle du poème qui naît d’une impulsion à laquelle j’aurais du mal à résister – je sens que cela me nuirait, me fragiliserait.

Qu’est-ce qui vous a conduite à l’écriture et plus particulièrement à l’écriture poétique ?
Il m’a semblé que la densité de l’écriture poétique me permettrait d’exprimer l’essentiel. Je développe peu en écrivant des poèmes. Tout fuse, je suis un peu débordée. Par ce que je ressens, l’urgence à dire qui ne peut s’embarrasser de détours. Vite, il faut aller vite avant que s’éteigne l’élan.
J’écrivais enfant comme on le fait un peu tous, un journal, un poème, un roman perdu. La prédilection pour la poésie a tardé mais elle s’est imposée sans concurrence d’autres formes tant pour la lecture que pour l’écriture.
Et cet élan, d’où provient-il ? Avez-vous besoin de ce que l’on appelle communément l’inspiration pour écrire ou est-ce le travail sur la langue elle-même qui produit de l’écriture ?
Cet élan vient de loin, de quelque chose qui n’est pas maîtrisé. Une énergie vitale, un questionnement, un manque – née avec sans que je puisse expliquer cela. Écrire, c’est accepter des forces paradoxales qui m’animent, me font avancer, renoncer, reprendre. Ce n’est pas apaisé – cela ne veut pas l’être. La liberté éprouvée en écrivant se manifeste par une course. La langue est cette chose malléable, un matériau que je peux tordre ou infiniment respecter, c’est selon. Je n’ai jamais peur lorsque j’écris, je garde tout ce qui me semble nécessaire. Je n’éprouve jamais de difficultés à écrire car je n’écris que lorsque j’en ressens le besoin (je parle des poèmes), je peux rester silencieuse et cela ne me perturbe pas, d’autant que parallèlement je lis, j’écris des articles et, là, le fonctionnement est tout autre. Lorsque vous parlez du travail sur la langue, je pense au second temps. Quand je dispose d’un corpus, je vais avoir le désir qu’un livre existe. Pour préparer ce livre, je vais relire, extraire, organiser, supprimer, restreindre, écrire d’autres poèmes nés de ces relectures. Le premier temps est spontané, le second est beaucoup plus orchestré et réfléchi. Ce n’est pas du tout le même tempo.

La poétesse Kim Doré confie dans un entretien qu’elle va chercher l’inspiration partout et n’importe où, sauf en poésie, « qui peut avoir cette tendance à se mirer, à s’auto-interroger, à se complaire dans les réflexions sur elle-même » [1]. Elle dit trouver plus facilement matière à poésie dans la botanique, l’astronomie, la biologie. On sait l’importance dans votre univers du monde floral. Diriez-vous que votre principale source d’inspiration se situe hors du champ poétique ?
Tout ce que je vis et regarde peut apparaître dans l’écriture. Tout ce que je lis aussi mais pas de manière consciente d’abord. Quelque chose déborde, je dois le formuler pour retrouver une forme d’apaisement. Et puis la plupart de mes poèmes sont adressés, même si cela n’apparaît pas nettement : j’écris pour quelqu’un, pour être entendue de quelqu’un. Le destinataire n’est pas toujours le même mais il préexiste au texte. Je m’en rends compte en les relisant, je ne suis jamais seule dans les poèmes. Ils tiennent un fil de joie, un instant, ils appellent au secours aussi ou tentent de rétablir quelque chose qui est perdu. Vous évoquez la botanique, l’astronomie, la biologie, je trouve porteuses l’ouverture et la rencontre que constitue le poème. Donc, oui, tout ce qui est autour de nous, ce qui est perçu passe par le prisme d’un vécu qui s’énonce. Curieusement et de manière candide, en écrivant, je sens que quelque chose m’échappe, que je ne l’aurais pas exprimé sans le poème et qu’écrire me permet de coïncider avec moi-même et de trouver ma place. En étant moi-même ainsi, j’espère rejoindre les autres.

Lorsque vous parlez de la densité de l’écriture poétique, vous précisez que vous développez peu. À vous lire, on peut également penser que vous écrivez par épuration, dépouillant le vers de ce qui serait superflu. Êtes-vous une adepte de la rature ? Procédez-vous par soustraction ?
Oui je soustrais beaucoup, tout ce qui me semble superflu, je le rature ou le coupe. L’expansion est réservée à de rares moments d’écriture. Je crois que je raye moins qu’avant (dans Nous le temps l’oubli, par exemple, mon premier livre à L’herbe qui tremble). Et il me vient à l’esprit que deux formes de ratures coexistent : celle qui biffe des idées inutiles et celle qui ôte les mots qui gênent ou empêchent. Pour fuser, pour trouver le tempo, il est souvent nécessaire de se débarrasser de certains mots (des déterminants, souvent). Je suis très sensible, en lisant et en écrivant, au rythme. Cette soustraction va souvent de pair avec une discordance. Impair et cogne. Et puis on peut rayer avec rage ou posément, je pratique ces deux formes. L’une permet de se défaire comme on expulse un corps étranger de soi, dans une blessure par exemple, l’autre est plus réfléchie, moins instinctive, elle opère avec la conscience et la volonté d’un équilibre. En tout cas, ce que vous remarquez est très juste, j’opère par soustraction volontiers, je pratique très peu l’inverse.
J’aime les lectures publiques car, en lisant, on peut souligner les ruptures, les manques, les silences. Ralentir, accélérer. Rythme, sonorités, assonances et allitérations surgissent ainsi au fil de la lecture… Les ellipses jouent un rôle essentiel dans cette musicalité langagière. Elles permettent des ruptures rythmiques nettes, des courses, parfois une forme de brutalité délibérée et assumée, une brisure dans le chant, une « lézarde » comme le décrit Jacques Roman dans Le dit du raturé ///// Le dit du lézardé (Isabelle Sauvage, 2013) : cette lézarde est « [i]nsoumise, imprévisible, de la création elle est le vœu naissant de la blessure. » Elle n’attend pas d’être comblée.

Vous évoquez les lectures publiques de vos textes. Si on oppose souvent l’oralité et l’écriture, diriez-vous, à l’instar de Serge Pey, que « toute écriture est une tentative de créer une nouvelle oralité » [2], ou, au contraire, à la suite de Julien d’Abrigeon, qu’un « poème lu en public [doit] être écrit pour cela, dans cette optique pour ne pas plaquer une oralité feinte à des textes qui n’ont pas cette finalité » [3] ?
Je me garderai bien de généraliser à ce sujet comme à bien d’autres. La poésie a des visages bien divers. Parfois visuelle comme la poésie spatialiste, parfois purement orale comme dans certaines traditions. Un poète comme Pierre Garnier a connu de grandes réussites avec ses poèmes « linéaires » comme avec ses poèmes spatialistes. Ce que j’ai dit précédemment ne concerne que ma propre pratique. Les mots écrits ont bien sûr une existence d’abord visuelle, mais ils portent aussi des sons. L’auditeur peut juger de la validité de ce qu’il entend, mais ce qu’il entend ne dépend pas que du texte. Et celui ou celle qui dit les textes est aussi en cause, je cherche personnellement un équilibre entre l’expressivité de la lecture et un espace laissé vacant pour que la personne qui écoute trouve sa place sans que lui soit imposé un sens unique. J’aime que le poème reste ouvert et que chaque lecteur puisse, s’il le désire, faire chemin avec ce texte, dans ce texte. La singularité d’une voix n’est pas incompatible avec l’universalité si l’on peut penser que chacun vivra sa propre appropriation du poème lu ou écouté. Par exemple, j’ai l’impression que ce que je vis nourrit mes livres mais que cela n’empêche aucune autre projection personnelle même si les éléments biographiques se limitent à ma sphère de vie. Je lis aussi les autres poètes ainsi, comme si le narrateur n’offrait qu’un parcours pour qu’il se démultiplie et s’incarne sans fin en d’autres possibles. D’autre part, pour ce qui est de l’éventuelle « nouvelle oralité » de la langue, je crois qu’il s’agit d’abord de l’individualité de la « voix » du poète…

Vous dites que la plupart de vos poèmes s’adressent à quelqu’un. Votre œuvre, dans laquelle on retrouve effectivement souvent un « je » qui s’adresse à un « tu », prend parfois une tonalité très intimiste. Cependant, vous parlez également de la force de soulèvement du poème comme d’une force insurrectionnelle. Diriez-vous que le poème est le théâtre de la tension entre l’être et le monde (ou du moins la représentation du monde) et que cette tension se joue dans la langue ?
Oui, je perçois le poème comme un lieu de tension entre l’être et… autre chose, qui peut être le monde de manière générale mais qui peut aussi prendre des visages plus particuliers. Ce qui s’y manifeste, c’est un « je », mais aussi un « hors je », un « nous ». Georges Didi-Huberman a analysé, de façon générale, ce qu’est cette force de soulèvement dans le premier volume de Désirer, désobéir. Mais je dois dire que ce que j’écris en poésie ne repose pas sur une pensée philosophique construite. Je suis dans la langue, et une langue qui refuse l’usure des mots, leur usage affadi. Et puis j’aime la syntaxe, sa dissonance lorsque quelque chose la dérègle : un grain de sable, une attente déjouée qui permet le soulèvement. Modestement. Car tout cela s’opère incidemment. Je dois m’éprouver libre pour écrire les poèmes, je suis parfois surprise par des formules qui me révèlent quelque chose que je n’ignorais pas mais que je n’exprimais pas.
Avez-vous déjà une idée de la forme qu’aura le livre au moment où vous en commencez l’écriture ? Pensez-vous que se donner des contraintes est nécessaire à l’égard du poème ?
Je n’ai jamais idée de la forme aboutie du livre. Je décide de collecter des textes parmi un ensemble, au fur et à mesure de cette collecte me vient l’idée d’une direction mais c’est souvent peu précis : plus un désir que réellement un trajet. Je rassemble toujours beaucoup plus de poèmes que nécessaire, leur nombre se réduira parce que certains ne me paraissent pas tenir ou parce que finalement ils sont trop loin de ce que je souhaiterais pour le livre. Commence alors un travail de coupe – et je n’y vais pas de main morte. J’aime bien cette étape : faucher, en retirant des poèmes, tailler en souhaitant trouver pour les vers une forme plus tranchante et percutante. J’ai des doutes, parfois je me repens d’avoir écarté certains poèmes que je réintègre en changeant leur forme. Ensuite tout se décidera par rapport à l’ensemble, au rythme (espérant éviter la monotonie). L’idée est toujours que le livre est un poème, avec bien sûr des ruptures, ce qui ne manque pas dans En découdre. Tout ce travail prend des jours. Je ne me fixe pas de contrainte formelle, je ne l’ai jamais fait pour l’instant. Disant cela, je pense à des textes non publiés sauf en revue, dans Diérèse, justifiés et sans ponctuation, c’est donc une exception. Je me sentirais bridée avec des contraintes, or ce qui s’écrit jaillit. (Peut-être le ferai-je un jour cependant, je ne sais pas).
Je ne pars donc jamais d’une contrainte, ni même d’un projet précis (sauf pour Ossature du silence, les encres de mon père ont déterminé l’écriture d’un livre consacré à l’enfance et à son lieu, Les Andelys). Les contraintes ont permis de grandes réussites : des sonnets de tant de poètes jusqu’à des objets poétiques remarquables comme La Sauvagerie de Pierre Vinclair. Les contraintes peuvent donc être très productives, mais pas pour moi jusqu’alors.

Vous êtes poétesse et critique. Vous proposez des lectures et des entretiens notamment dans Quinzaines, ainsi que dans les revues Europe et Terre à ciel. Diriez-vous que votre activité critique nourrit votre écriture poétique ?
Je ne formulerais pas cela ainsi car, si c’est le cas, elle la nourrit de manière inconsciente. L’une me repose de l’autre et surtout m’équilibre. Et puis je réagis vivement à ce que je lis, l’écrire est une manière naturelle d’exprimer un bouillonnement que j’éprouve en lisant et j’ai toujours, pour plusieurs poètes, une reconnaissance infinie pour leur faculté à créer une forme dont l’évidence me stupéfie et me fait réfléchir. L’activité critique est née de l’admiration, il m’a semblé inconcevable de ne pas l’exprimer.
Hormis vos articles, écrivez-vous exclusivement de la poésie ?
Oui, je n’écris que poésie et articles. Pour les articles, d’ailleurs, quand j’écris sur les livres d’auteurs, je me laisse porter par l’inspiration comme pour mes poèmes. L’écriture des articles n’est pas toujours totalement différente de celle des poèmes, il y a le plus souvent un moment, au début de l’écriture de l’article, où je me laisse porter par ce que je lis. Le travail plus technique sur les références explicites ou implicites du livre n’intervient qu’après.
Vos derniers livres sont accompagnés d’œuvres de Marie Alloy et Fabrice Rebeyrolle, et vous avez également travaillé avec d’autres peintres. Est-ce que leurs œuvres étaient à l’origine du livre ? Comment travaillez-vous avec les peintres ?
J’aime beaucoup que vous évoquiez les peintres : leurs œuvres m’inspirent.
Pour Voltige !, une fois le livre constitué, j’ai choisi des œuvres de Colette Deblé à partir des propositions de l’artiste. Pour les autres livres, les artistes ont travaillé à partir des poèmes. J’ai eu la chance que l’un de mes premiers éditeurs, Daniel Martinez et Les Deux-Siciles, me laisse l’opportunité de solliciter Jean-Gilles Badaire pour mon premier livre avec un peintre, Un peu de ciel ou de matin. Dans ce cas précisément, j’ai adressé le manuscrit à Jean-Gilles Badaire qui a peint après l’avoir lu.
Il se trouve que les éditions Al Manar et L’herbe qui tremble publient le plus souvent les livres de poésie avec des peintures également, ce qui m’a permis de travailler avec Marie Alloy, Christian Gardair et Fabrice Rebeyrolle. La collaboration est toujours passionnante quand nous pouvons avoir de véritables échanges, avec de belles surprises. Ainsi, pour Nous le temps l’oubli, Christian Gardair a encore réalisé une série de dessins après la parution du livre, ce qui a donné lieu à une exposition dans une galerie parisienne.
Et puis ces découvertes ont aussi permis, parfois, de réaliser des feuilles peintes à quelques exemplaires, avec Colette Deblé, Gaetano Persechini ou Caroline François-Rubino, ou bien des livres d’artiste, avec Marie Alloy et Fabrice Rebeyrolle. Avec ce dernier notamment, le dialogue est particulièrement suivi et fécond. C’est un grand lecteur de poésie. Après sa série de peintures pour Chemin des centaurées, il a réalisé la couverture et un frontispice pour En découdre. Il a multiplié les essais et nous avons pu en discuter longuement. J’ai pu réaliser avec lui un carnet d’entretiens et écrire des poèmes à la suite de la visite de son atelier. Nous avons exploré ensemble différents formats de carnets. C’est dans ces circonstances qu’il m’arrive d’écrire à partir de peintures. D’autres projets sont aussi en cours avec Fabrice Rebeyrolle et plusieurs autres artistes, en particulier Caroline François-Rubino qui fait se croiser nos chemins, et Michel Remaud qui sait si bien projeter le poème dans la couleur, et en retenir les rythmes et la lumière, éblouissante comme noire.
La réalisation de feuilles peintes ou de livres d’artiste est l’une des activités que je préfère. C’est une stimulation constante et un enchantement de faire coexister deux formes d’expressions.

Quels sont les peintres avec lesquels vous souhaiteriez travailler ?
C’est bien, une question sur les rêves…
J’aimerais beaucoup poursuivre le travail avec les peintres évoqués, dans lequel je suis déjà très engagée, mais, c’est vrai, j’ai toujours rêvé d’un livre d’artiste avec Anselm Kieffer – je ne l’ai jamais rencontré et n’ai pas osé le solliciter.
Vous êtes l’autrice de plus d’une dizaine d’ouvrages depuis 2010. Existe-il selon vous un lien, conscient ou inconscient, entre tous vos livres ?
Il me semble que je me déplace dans une même constellation née du manque. Au départ même, alors que vivants nous sommes, quelque chose de manière ontologique manque. C’est naître qui l’engendre comme si, pour moi en tout cas, il fallait toujours explorer pour compléter, recoudre les fragments d’un même tout inatteignable. Cette absence est nourrie par ce que nous vivons, elle est compensée aussi à certains moments par ce qui se passe entre les êtres et avec le monde. Elle reste. Toujours. Elle aiguillonne. Je ne la déplore pas car c’est le sens donné à la vie.
Diriez-vous que l’ensemble de vos livres publiés constitue aujourd’hui une œuvre ? Pensez-vous à vos livres en ces termes ?
Je dirais que chaque livre donne une direction, suit un parcours d’exploration. Il exprime souvent des retrouvailles avec le passé, avec un être perdu. Je rassemble, j’envisage, je compose des suites qui s’interrompent puis se rejouent ailleurs. Les livres en témoignent et En découdre, par exemple, ne cesse de concilier, de rapprocher des données contraires. À l’impossible, je me sens tenue dans les livres. Ils m’offrent une liberté qui est celle, sans doute, de la poésie. Rien, ici, n’est restreint, exclu. Il suffit d’abord de laisser poindre et jaillir et ce mouvement, qui rejoint sans doute celui de la naissance, est d’abord libérateur. Il faut que se dise ainsi.
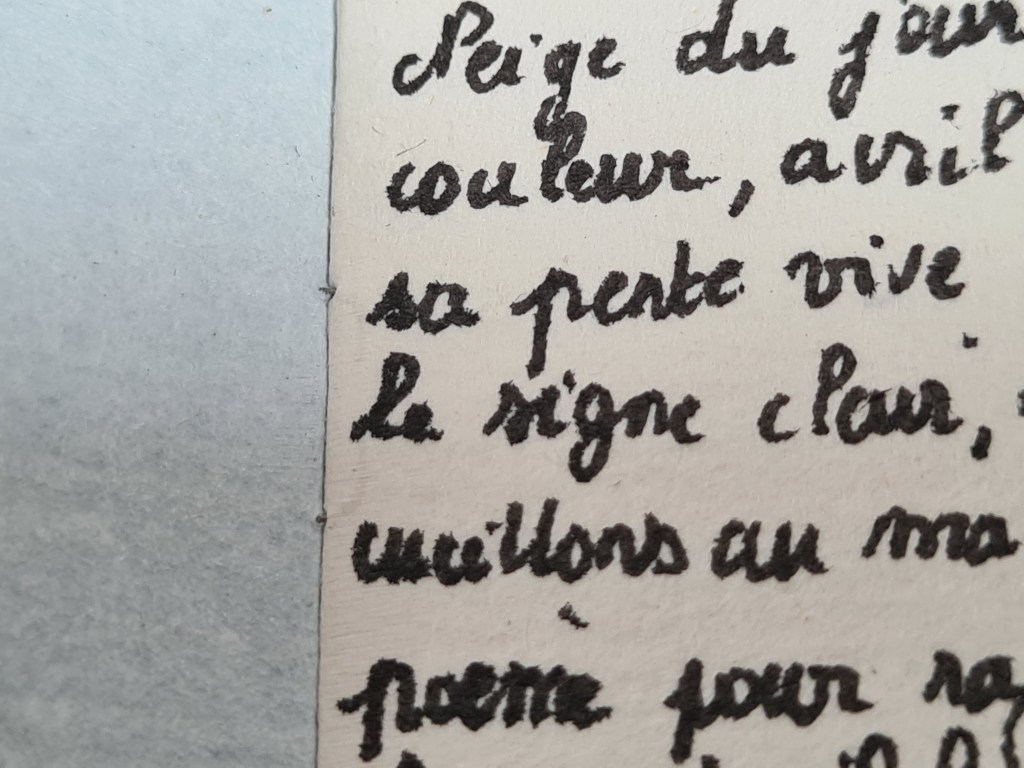
À quoi ressemble votre table de travail ? Avez-vous un lieu privilégié pour écrire ?
Ma table de travail ressemble à un chantier, il y règne un immense désordre rassurant pour moi. Je ne peux garder mon bureau « rangé » plus d’un jour. Il me faut saper tout cela. J’écris sur un bureau de verre transparent que je couvre de lettres (les dernières reçues), l’écriture manuscrite de quelques proches m’est précieuse, des livres en cours de lectures, de notes sur ce que je dois penser à faire. Un grand meuble bibliothèque longe ce bureau, des livres essentiellement mais aussi du papier à lettres, des carnets, de vieilles marionnettes… J’aime écrire à ce bureau, la pièce est minuscule mais elle est ouverte sur la lumière de la cour. Je peux écrire ailleurs même si c’est là que je préfère le faire.
Travaillez-vous actuellement à un nouveau livre ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Un livre est en préparation à L’herbe qui tremble. Je voulais depuis longtemps écrire pour mon père disparu. Ce livre est pour lui.
J’ai plusieurs projets en cours, avec des amis peintres et cela me ravit. J’aime ne pas porter un livre seule et que le livre, avec la peinture, s’ouvre à une autre perspective.
Entretien réalisé par courrier électronique de juin à août 2021. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photographie de l’autrice en Une DR.
[1] https://www.ledevoir.com/lire/370938/kim-dore-contaminer-par-la-poesie
[2] Entretien avec Serge Pey publié dans le numéro 223 (mai 2021) du Matricule des anges.
[3] Entretien avec Julien d’Abrigeon publié dans Un dernier livre avant la fin du monde : https://www.undernierlivre.net/entretien-julien-dabrigeon/