
Rim Battal, née à Casablanca en 1987, est artiste, poétesse et journaliste. Après des études à l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication de Rabat, elle devient rédactrice en chef du mensuel francophone Métropolis dédié à la culture urbaine. En 2013, elle réside à la Cité internationale des Arts et au Studio IWA de Casablanca. Depuis 2016 elle a rejoint le Bordel de la Poésie de Paris où elle pratique des lectures performées de ses textes.
Entre Paris et Marrakech, elle se consacre à l’écriture et à la photographie. Ses premiers recueils Vingt poèmes et des poussières, Latex et Transport commun ont été publiés chez LansKine. En 2019 paraît aux éditions Supernova L’Eau du bain. Son nouveau recueil, Les Quatrains de l’all inclusive, paraîtra en février 2021 chez Le Castor Astral.
Rencontre placée sous le signe du feu avec une poétesse qui figure pour Les Inrocks parmi les« 10 poètes nouvelle génération à suivre sur les réseaux sociaux » [1] et dont le recueil Latex est cité parmi « les dix livres à lire pour découvrir la poésie qui s’écrit aujourd’hui » dans Libération [2].
 Dans votre premier recueil, Vingt poèmes et des poussières, publié en 2015 chez LansKine, nous pouvons voir quelques-unes de vos photographies tirées de votre série « Mes baigneuses », ce qui ne sera plus le cas dans vos recueils suivants. Était-ce pour vous une manière de tisser un lien entre votre activité de photographe, qui a précédé l’écriture, et la poésie ?
Dans votre premier recueil, Vingt poèmes et des poussières, publié en 2015 chez LansKine, nous pouvons voir quelques-unes de vos photographies tirées de votre série « Mes baigneuses », ce qui ne sera plus le cas dans vos recueils suivants. Était-ce pour vous une manière de tisser un lien entre votre activité de photographe, qui a précédé l’écriture, et la poésie ?
C’était à la fois un lien et une transition. Une sorte de pont. La photo qui introduit la poésie en quelque sorte. Avant de publier ce premier recueil, j’avais déjà exposé mes photographies et j’étais repérée (au Maroc à l’époque (« repérée ahaha »)) comme photographe (en plus du journalisme que j’avais étudié et que j’exerçais). On ne savait pas que j’écrivais. Moi-même je ne le savais pas très bien. Je l’ai su quand Catherine Tourné a accepté mon premier manuscrit. Ce même recueil sera utilisé comme support de cours de photolittérature à la fac de Lyon par une professeure que j’admire (en plus !), Pr. Touriya Fili, qui suit mon travail depuis le début, m’a toujours soutenue depuis la sortie de ce premier livre.
Le titre du premier poème donne la tonalité teintée de cet humour très personnel que l’on retrouve dans plusieurs de vos écrits : « J’ai cassé ma tasse de café ce matin et je crois que je suis encore grise de la veille. Haha. » L’interjection « haha », qui revient souvent dans vos poèmes, semble montrer l’importance que vous accordez à l’autodérision dans votre œuvre. Est-ce pour affirmer que la poétesse que vous êtes ne doit pas se prendre (trop) au sérieux ?
C’est vraiment une manière d’appréhender le monde, en fait. En rire, pour garder sa tête pour soi. Le rire est une souplesse indispensable, une distance, une torsion du drame. Je viens du Maroc. Un pays où même lorsqu’on a été privilégié, lorsqu’on est plus ou moins protégé (par une famille aimante, un toit, etc.) l’on vit énormément de drames, on vit exposé à tout. Drames politiques, sociaux, économiques, de genre, etc. Et paradoxalement — en fait, ce n’est pas paradoxal, ça peut paraître paradoxal — c’est un pays où on rit beaucoup, de tout, on rit même de la langue, avec elle, on la tord, la transforme pour construire ou improviser une plaisanterie, un trait d’esprit, composer une chanson pour son club de foot…
D’ailleurs, contrairement à l’image qu’on a des payzarabes vus d’ici, l’humour au Maroc peut être très blasphématoire. Simplement, les gens ont envie de rire eux-mêmes d’eux-mêmes, non pas qu’on les insulte sous couvert d’humour. Parce que c’est cela qui est fait quand c’est une personne ou une institution puissante économiquement et politiquement qui vient démonter les croyances de l’autre sous couvert d’humour. On ne rit pas d’une béquille. C’est aux personnes concernées de décortiquer, déconstruire elles-mêmes.
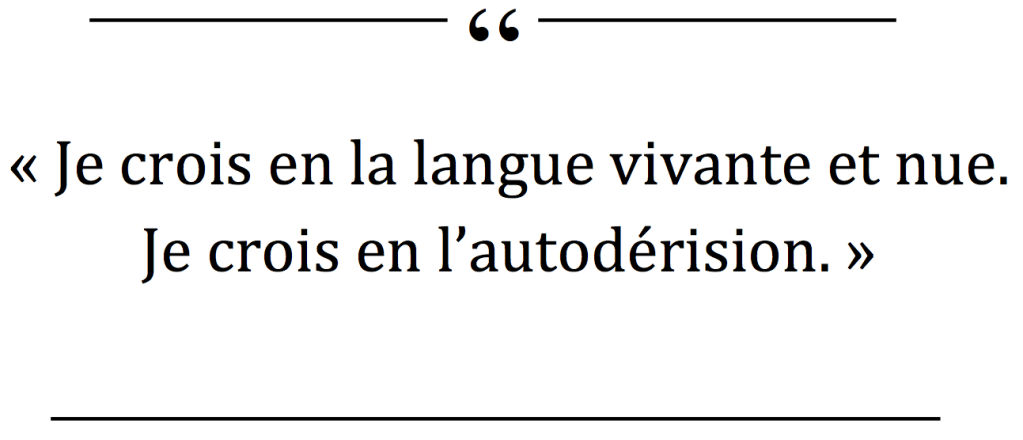
Personnellement, le blasphème ne me fait absolument pas rire. Casser la langue, oui. Ça me fait rire. Blasphémer et même entendre un blasphème ne me fait ni chaud ni froid ; le blasphème ne fait rire que les croyants, les mi-cuits ou les personnes qui n’arrivent pas à se défaire de leur foi malgré un travail de déconstruction. Je crois en la langue vivante et nue. Je crois en l’autodérision. Quand on rit de l’autre, on l’empêche d’avoir de l’autodérision.
« (Les mères ont des mères aussi, / je n’ai jamais compris) », écrivez-vous sous forme d’incise dans le poème « Rêve d’or ». Ces deux vers, ainsi protégés par ces parenthèses, me semblent importants. Je pense évidemment à L’Eau du bain dont nous reparlerons plus loin. Dans votre œuvre, les figures féminines ne gravitent-elles pas toutes autour de la figure maternelle ?
En effet, j’ai mis du temps à le voir mais oui. Pour moi, la figure maternelle est importante — une figure qui peut être également incarnée par une personne qui n’a jamais eu d’enfant ou ne peut pas en avoir. La maternité, c’est une posture, une façon (une volonté) de prendre l’autre à la fois sous son aile et sous son joug. C’est pour cela qu’elle apparait comme une figure divine car elle emprunte aux dieux dans leurs largesses et leurs colères. Or c’est une divinité qui a une ascendance. Ce qui apparaît comme tout à fait hallucinant pour une personne qui n’a d’abord connu de la religion que les monothéismes et encore plus l’islam où Allah est seul, unique, absolu.
La mère, qu’on ne connait d’abord que de l’intérieur, est l’univers entier pour le bébé qu’elle porte. C’est quand sort le bébé et grandit qu’il réalise que l’univers a un visage, une mère lui-même, des failles et des traumatismes, un ego. Et là on se dit meeeeeerde, on est mal barré !
Et on pose des parenthèses pour encadrer tout ça : le contenir et à la fois signifier la finitude de cette figure divine.

Dans le poème « Moi, je, toi, qui », vous écrivez : « Moi qui ne suis rien encore » (p. 35). Est-ce à partir de ce livre que vous avez eu le sentiment d’être devenue écrivaine ?
Pas vraiment. « Rien » n’a pas « écrivaine » pour opposé. J’étais assez jeune quand j’ai écrit ces poèmes. Enfin, beaucoup moins jeune que quelques prodiges qui sortent des livres à 16 ans ou qui ont des fulgurances bien avant, certes… (à 16 ans, j’étais noyée sous mes hormones en ébullition, contrariées dans leurs désirs ahaha) je me cherchais, nous étions en mutation mes différentes pratiques et moi-même et c’est un peu un hasard que cela se soit arrêté sur la poésie. C’est peut-être même pour ça d’ailleurs, la poésie, c’est l’outil de composition d’idées en mutation. Ce qui est plus difficile à faire avec un roman ou un essai par exemple. C’est l’écriture de la mutation. Et j’étais en train de muter ou muer quand j’ai écrit ce poème. J’ai eu le sentiment d’être devenue écrivaine en janvier 2020 lors d’une lecture à la maison de la poésie de Paris. J’ai lu des extraits de mon recueil à paraître, Les Quatrains de l’all inclusive, dont un qui se termine ainsi : « Voici un poème sur le poème / Suis-je enfin poète ? »
Dès que j’ai fini, Séverine Daucourt, qui lisait Transparaître [LansKine, 2019 — NDLR] ce soir-là, est venue me voir et m’a dit « Rim, tu es une vraie poète ».
J’ai attendu de rentrer chez moi pour pleurer ; c’était la première fois que quelqu’un que j’estimais profondément me reconnaissait sans réserve, de manière aussi frontale.

« Je n’ai que le pouvoir que vous me donnez », lit-on dans « Moi, vous ». Dans son Lector in fabula Umberto Eco parle de la nécessité de faire faire le travail par le lecteur. Pensez-vous, vous aussi, que les lectrices et les lecteurs doivent « faire le travail » ?
Complètement. Si on ne lit pas pour co-écrire, penser avec l’auteur ou autrice, construire ou déconstruire ensemble, se fâcher parce qu’on aurait fait le travail différemment, parce qu’il y manque des choses, transformer ce qu’on lit en quelque chose de plus personnel, donc plus universel, ce n’est même pas la peine. Il vaut mieux regarder The Voice, c’est plus divertissant.
Personnellement, je publie ou désire publier un ouvrage quand je le pense incomplet, quand ce qui s’y développe n’est pas tout à fait abouti. Pas bâclé, incomplet. Ce qui pousse à publier, c’est peut-être ça, l’envie que l’autre — lecteurice, critique, éditeurice, étudiant,e — complète ce travail premier par une adaptation personnelle et libre, un démantèlement violent… toute création est une course de relais.
Les idées viennent de quelque part, elles flottent au-dessus ou en-dessous ou tout autour dans un monde fini, immenssissime mais fini. Qu’il s’agit simplement de transformer en permanence, adapter à un instant t, un contexte, augmenter, compléter, disloquer, traduire, etc. C’est pour ça que j’ai trouvé ça génial que Pierre Vinclair me propose d’écrire un texte à trous récemment [3]. C’est ça en vrai, écrire, pour être lue, c’est laisser des trous. Il faut laisser des trous. Sinon, c’est de la tyrannie et du conditionnement, une dictature.
« Je vous écris du passé », lit-on dans le poème « La vilaine ! ». Entre passé et présent, Maroc et France, d’où écrivez-vous ?
Je travaille sur un texte qui s’appelle Un pays qui te ressemble. On saura précisément d’où j’écris quand il sera terminé et à mon avis ce texte-là prendra une vie. Il en paraîtra des bouts dans des revues, en cours de route. Cela dit, j’ai répondu à une question similaire pour Terre à ciel (grâce à Clara Regy) l’année dernière et je pense que — pour l’instant — la réponse est encore valable [4].
« Elle saignait de partout / femme fontaine / […] Déchiré, est son hymen », écrivez-vous dans « St Beast ». Le sexe féminin, l’hymen, sont des motifs récurrents dans votre œuvre de photographe (je pense à certaines photos de votre série « Altérer/désaltérer ») et de poétesse. Vous avez d’ailleurs participé au projet « Hymen redéfinitions » en publiant en feuilleton un texte intitulé L’Œil des Loups [5]. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet porté par un collectif du même nom ?
Cette histoire de lien entre hymen et virginité (lien fictif, mensonger — j’invite vivement à se rendre sur le site www.hymenredefinitions.com pour se renseigner là-dessus) renferme un nœud essentiel dans ces histoires de violences faites aux femmes et au féminin plus généralement, à la maternité comme exercice du pouvoir, au sentiment de peur, de fardeau et de haine que l’on peut développer vis-à-vis de son propre corps, de crainte de la sexualité et du désir féminin.
Aussi, quand Isabelle Querlé, autrice et fondatrice du site, m’a proposé de participer au projet d’une façon ou d’une autre j’ai repoussé gentiment au départ. Je me suis soudain retrouvée devant quelque chose de trop lourd à porter, sans savoir pourquoi au juste. J’étais heureuse qu’Isabelle le fasse, aidée d’autres femmes, historiennes, scientifiques, littéraires, etc. mais je me souviens avoir ressenti une sorte de haut-le-cœur et je me suis dit « je n’ai rien à dire sur le sujet ».
Quelques mois plus tard, je me suis souvenue avoir vécu cette oppression-là dans ma chair, qu’il a fallu qu’une adolescence compliquée (très sage, trop sage justement, sans substances qui altèrent la conscience pour adoucir sa foudre, vécue de plein fouet) se couronne par un fait majeur et scandaleux : ma mère m’avait demandé de fournir un certificat de virginité quand j’avais 19 ans. « L’œil des loups » a donc coulé tout seul depuis cette source qui me semblait lointaine, me faisant autant de mal que de bien au passage. C’est une histoire vraie, malheureusement.
Dans un entretien, vous dites que Vingt poèmes et des poussières « est un recueil que l’on s’approprie, que l’on effeuille au lieu de feuilleter. […] Car les poèmes qui y figurent sont très visuels. La plupart sont plutôt composés pour être regardés, presque touchés ; lus dans l’intimité plutôt que récités, déclamés » [6]. On pourrait voir dans vos propos, qui semblent évoquer une performance de strip-tease, une sorte de prémonition du Bordel de la poésie auquel vous participez. Importés de New York où ils sont apparus en 2008, les bordels de la poésie ont gagné l’Europe, Londres, Barcelone, Bruxelles et Paris en 2014. Dans une ambiance feutrée d’alcôves, poétesses et poètes murmurent leur poésie à l’oreille de client.e.s. Cette pratique a-t-elle influencé votre écriture ?
Ah Le Bordel de la Poésie, ça me manque terriblement. Quel bel endroit ! Je sais déjà que je vais pleurer d’émotion lors de la première lecture en tête-à-tête, post-covid, dans une alcôve du Bordel de la poésie. Réservez vos places tout de suite, ahaha
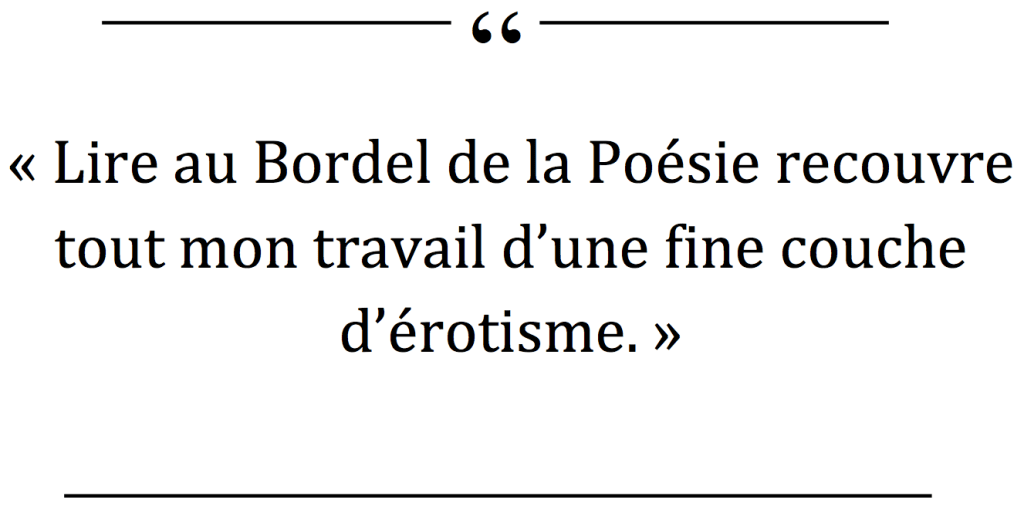
La pratique — c’est-à-dire lire en tête-à-tête mes textes, habillée en putain d’un autre temps — , n’a pas plus influencé mon écriture que le fait de pratiquer la lecture publique de façon rémunérée. Il y a eu un passage à l’oralité de toutes façons et à la professionnalisation. Par contre, cela en influence la réception : le fait d’y lire recouvre tout mon travail d’une fine couche d’érotisme depuis. Peu importe ce que je lis ou écris, les gens sont excités, je sais pas pourquoi ahaha
Enfin, si. Je sais.

Êtes-vous aujourd’hui encore celle qui publiait Vingt poèmes et des poussières en 2015 ?
C’est pendant la petite enfance que l’on a la plus forte intuition de soi-même, qu’on est le plus proche de sa vérité. Viennent ensuite culture, éducation et rencontres, contre-culture qui nous apprennent à adapter ce matériau premier aux exigences de « la vie » et du « monde » (vie et monde à un instant t, dans un lieu donné). Qui nous rendent « viables » d’une certaine façon mais nous déforment aussi. J’ai eu personnellement cette expérience de l’enfance deux fois : en étant mère et en étant enfant moi-même. Je me souviens d’une grande forme de lucidité quand j’étais enfant — que je constate aujourd’hui en observant mes propres enfants d’ailleurs, que tous les enfants doivent certainement avoir. J’avais conscience d’être enfant, de posséder quelque chose de sacré que l’on essayait de m’enlever à l’école, la rue, dans les premiers cercles sociaux et premières formes de sociabilité, etc. et c’était très pénible. J’avais hâte de devenir adulte pour pouvoir enfin être enfant comme je le voulais. C’est un peu pareil dans la poésie. Vingt poèmes et des poussières était mon enfance dans l’écriture. Que j’ai un peu reniée dans Latex et Transport commun parce que j’étais en pleine croissance, comme une ado, avec la même fatigue physique et le même côté halluciné, qui essaye tout. Le temps des premières fois, le temps de vouloir être tous les autres sauf soi-même. Je ne suis plus celle de Vingt poèmes et des poussières mais j’en garde la douceur et le drame et me dirige tranquillement vers ma vérité poétique.

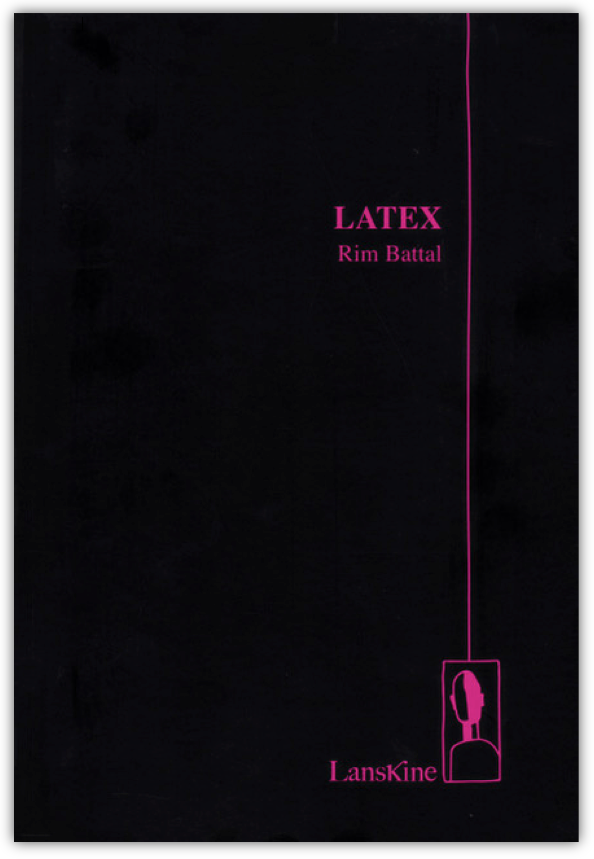 Pour votre deuxième livre publié chez LansKine, Latex, le recueil revêt une couverture noire et lisse qui n’est pas sans évoquer les tenues prisées par les adeptes de pratiques BDSM. Dès les premiers textes, la tonalité très crue est donnée : « Je. Me. Touche. », scandez-vous page 13. Votre intention en écrivant Latex était-elle d’aborder aussi crûment que poétiquement le désir féminin sans aucun tabou ?
Pour votre deuxième livre publié chez LansKine, Latex, le recueil revêt une couverture noire et lisse qui n’est pas sans évoquer les tenues prisées par les adeptes de pratiques BDSM. Dès les premiers textes, la tonalité très crue est donnée : « Je. Me. Touche. », scandez-vous page 13. Votre intention en écrivant Latex était-elle d’aborder aussi crûment que poétiquement le désir féminin sans aucun tabou ?
Non.
Mais ça m’amuse beaucoup toute cette incrédulité autour de la masturbation féminine, la sexualité et le désir féminins. Tout le monde tombe des nues dès qu’on exprime le moindre désir quand on est assimilée femme.
En fait, ça ne m’amuse pas ahaha
J’écris sur ce qui me semble beau et important. Le mot tabou est un mystère pour moi. La provocation affaire de clowns. Mes textes ne sont pas crus, ils sont juste honnêtes.

La représentation de la sexualité entraîne encore de nos jours de vives réactions. Certaines œuvres sont qualifiées de pornographiques, obscènes, lubriques, indécentes, etc. par des censeurs. Diriez-vous que votre œuvre est transgressive ― étant entendu que par transgression j’entends que l’œuvre interroge les limites ?
Non, pas du tout. Elle n’interroge rien, rien des limites mon œuvre, elle raconte et expose en essayant d’être le plus sincère possible, la plus nue possible. Ce sont les censeurs qui sont à la ramasse, coincés, de mauvaise foi. Ce sont les censeurs qui ont un problème avec le cul, ce n’est pas moi qui transgresse.
Vous interdisez-vous quelque chose quand vous écrivez ?
Oui. Il y a pas mal de choses auxquelles je ne toucherai pas du vivant de mes parents, par exemple. Parce qu’iels ne les comprendraient pas et que je les aime, qu’iels m’ont assez défendue et soutenue jusque-là et que je ne souhaite pas être leur boulet, pas finir en prison.
Donc oui, mais seulement par amour.
La première partie de votre recueil s’intitule « Actualités » et vous abordez les attentats terroristes dans plusieurs poèmes, notamment dans « Stalingrad* » où perce une puissante colère. La littérature, et plus particulièrement la poésie, s’inscrit habituellement dans un temps long. Pour vous la poésie doit-elle être en prise directe avec le quotidien ? La poétesse et le poète doivent-ils écrire en réaction aux événements, dans l’immédiateté ?
Ça dépend de qui et de quelle poésie et je ne pense pas que le devoir ait quoi que ce soit à voir avec l’écriture. Je ne me situe pas sur le temps long, perso. Je ne table pas sur une reconnaissance posthume et parler à une génération suivante hypothétique ne me fait pas rêver. Je suis une femme de maintenant (avec ce qu’être femme signifie aujourd’hui en 2020) parce qu’il n’y a que le présent qui soit vrai. Mais je n’écris pas pour l’immédiat non plus, il y a des gens qui font cela très bien comme Thomas Deslogis par exemple, avec ses Poèmes d’Actu pour Libération ou avant cela pour Fluctuat ou LCP.
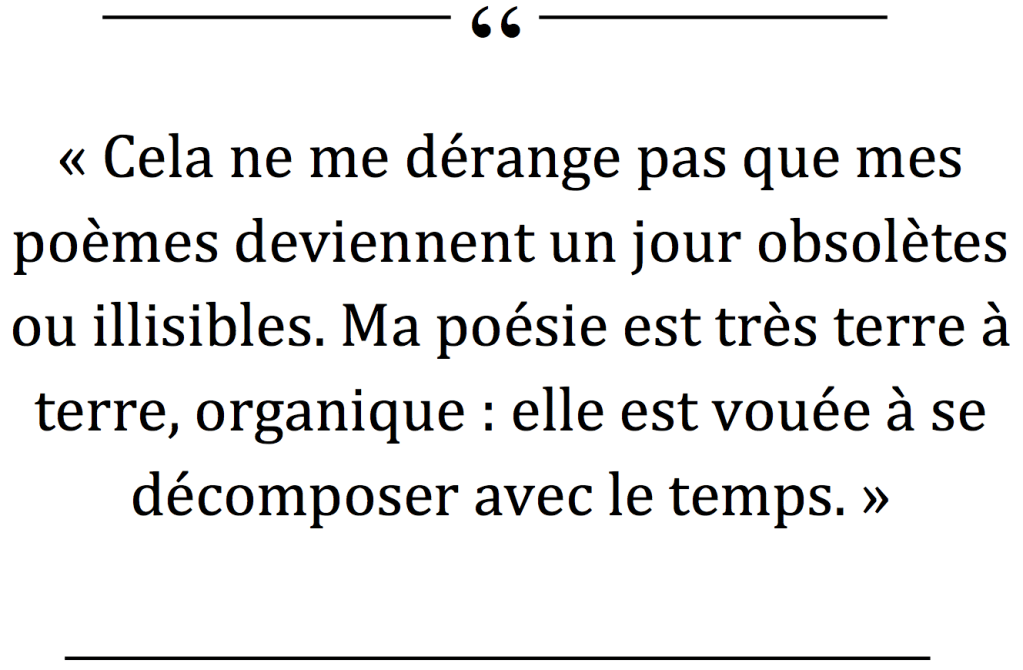
Je suis plutôt sur du moyen terme parce que je réfléchis lentement et que j’écris lentement, et cela ne me dérange absolument pas que mes poèmes deviennent un jour obsolètes ou illisibles dans une autre langue ou un pays lointain, parce qu’ils sont d’abord les enfants de leur contexte. Ma poésie est très terre à terre, organique : elle est vouée à se décomposer avec le temps. Et comme tout ce qui se décompose, elle deviendra sans doute autre chose, ne dépendra plus de ma volonté ni de mon essence.
Peut-être que mes poèmes serviront de document pour comprendre un jour les problématiques de notre époque et l’œil que l’on a pu poser dessus, un peu comme on regarderait des vieux tableaux chelou du moyen-âge, sans nuance, sans perspective mais qui nous renseignent sur l’esthétique de ce temps, les angoisses et les joies d’alors, les déplacements : la façon dont certains lions sont représentés sur certaines tapisseries démontre clairement que les gars, ils n’en avaient jamais vus, la laideur des bébés sur certaines toiles, le fait qu’ils aient des têtes de petit monsieur avec un corps proportionné comme celui d’un adulte mais en mini, nous dit que les gars ne s’étaient jamais occupés d’un enfant en bas âge.
Pour Michel Butor, ce qui s’écrit de plus intéressant aujourd’hui ne sera connu que dans vingt ans parce que, selon lui, cela surprend trop les éditeurs [7]. Qu’en pensez-vous ?
C’était peut-être vrai avant que Michel Butor n’existe et le dise mais je pense que cela est moins vrai aujourd’hui, post-Butor. Il a écrit ça quand ? Parce que vingt ans il y a vingt ans n’est pas vingt ans d’aujourd’hui. C’était peut-être vrai au temps où les éditeurices étaient un passage obligé pour se faire connaitre auprès du public, libraires, critiques, festivals, etc. Aujourd’hui, on peut aussi porter son travail sur internet. Ça veut dire quoi être connu ? auprès de qui ? être reconnu peut-être ? Je ne sais pas. Je n’en pense rien en fait ahaha
À vous lire, j’ai le sentiment qu’une volonté profonde vous anime de dépasser la seule contemplation de l’œuvre poétique ou photographique, ailleurs proposée comme une fin exclusive de l’activité littéraire et artistique. Ne cherchez-vous pas à substituer à une contemplation passive, des actions, des formes susceptibles de provoquer de nouveaux états de conscience chez celles et ceux qui regardent vos photographies, vous écoutent lors de vos performances et vous lisent ?
J’écris d’abord parce que je ne me reconnais dans pratiquement aucun des livres que j’ai lus. Ces livres m’ont façonnée, émue, dépaysée, ravie, révoltée, excitée, m’ont rendu l’autre plus intelligible, plus accessible, mais ne m’ont pas forcément apporté les réponses que j’en attendais. Ces livres m’ont nourrie mais je ne me suis jamais sentie repue. Quand je dis « je », je ne parle pas de ma petite personne : je pense que nous sommes légion dans un certain nombre de catégories qui se recoupent, une somme de contradictions. De même que pour les performances ou les vidéos que je regarde, il m’arrive de ne pas du tout m’y retrouver, ne pas comprendre d’où l’on parle. Je me sens larguée et parfois exclue délibérément, quasiment insultée. Je travaille donc à colmater les brèches comme grand nombre d’auteurices aujourd’hui. Que ce soit par l’écriture ou par le corps. Le corps est forcement en jeu quand on écrit, autant en jouer vraiment. Et si en faisant ce travail-là j’arrive à rapprocher des personnes d’elles-mêmes, formuler leurs intuitions, combler quelques-uns de leurs creux, y contribuer, alors je serai très heureuse.
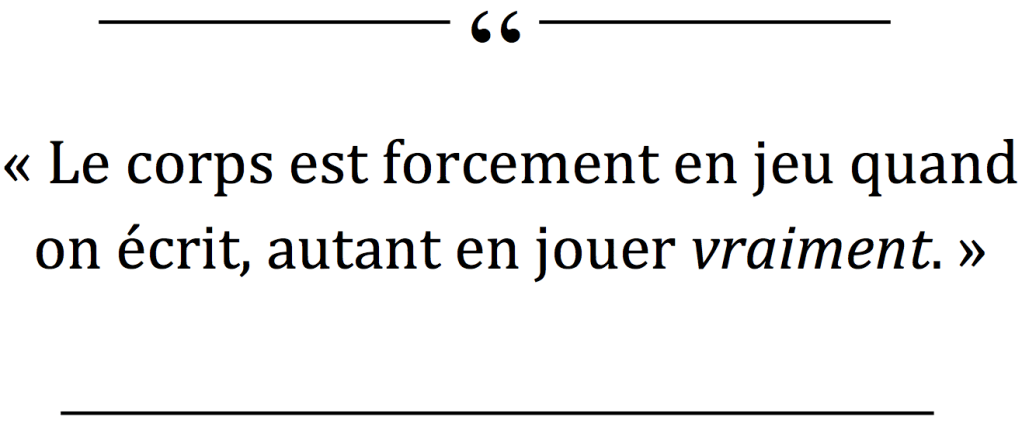
Qu’est-ce que la poésie pour vous ? Est-ce l’emploi d’une forme ou un regard posé sur le monde ?
C’est une question importante. Cette question n’a pas de réponse, en vrai. Parce qu’elle fait autant appel à l’histoire même de la poésie, sa genèse (pfiou ! le vertige !) qu’à des positionnements politiques très divers et parfois même opposés, qui se contredisent. Pour moi (je ne prends pas trop de risques), la poésie est une manière d’accepter sa propre vulnérabilité, sa finitude, d’embrasser ses trous. D’accepter de ne pas tout savoir. Donc oui, une façon de regarder le monde et de le recevoir. Mais je pense que la forme — quelle qu’elle soit — est importante également. La forme pouvant être autant un geste qu’un certain nombre de vers ou de syllabes agencées d’une façon plus ou moins canonique. Et je dis cela mais en même temps j’appelle à la méfiance du mot « poétique », du « poétique » comme adjectif parce que le risque est réel de dissoudre la poésie et la faire disparaître en tant qu’art à part entière dans une sorte de parfum fabriqué en série qu’on pchiterait sur toutes les choses fadasses pour leur donner du goût.

À la différence de Michel Houellebecq, qui avait tardivement reconnu avoir reproduit plusieurs passages mot à mot de notices provenant de l’encyclopédie participative en ligne Wikipédia pour son roman La Carte et le territoire, vous avez quant à vous opté pour la technique du cut-up expérimentée par Burroughs à la fin des années 50 pour votre texte « *Stalingrad » (sans omettre de citer votre source). L’enjeu du cut-up consistait-t-il pour vous à échapper à une forme d’illusion de possession des mots (« Depuis quand les mots appartiennent-ils à quelqu’un ? », se demandait Burroughs) et à interroger la position de l’autrice que vous êtes par rapport à l’objet-texte ?
Burroughs avait tout à fait raison. Les mots n’appartiennent à personne, ainsi que les gestes que l’ont reproduits, les sourires, les émotions que l’on ressent depuis des millions d’années que l’humain existe, les postures, les informations, le savoir.
(En discutant cet été avec une femme qui vend des formations aux entreprises, j’ai été très ébranlée par une chose. Elle affirmait que la bibliothèque (ou le stock) de personnalités possibles et très limité, qu’il était possible de connaître intimement les gens en leur posant des questions génériques et prévoir leurs réactions ensuite, leurs choix, leur comportement. Qu’on était tout a fait pré-déterminés. Elle a dit « mais personne n’est prêt à l’accepter » et je veux bien le croire. Les personnes qu’elle formait souvent rejetaient cette vérité simple, voulant être toujours plus complexes, plus intelligentes, redoutables. Moi-même je trouvais cela horrible, étroit comme une tombe. Mais quelque chose en moi sait que Léa — cette femme au regard puissant et la voix paisible — a raison et cela est tous les jours illustré par la façon qu’ont les réseaux sociaux de nous connaître, les publicitaires, les politiques, aidés par tous ces algorithme et ces cookies.)
Je cite mes sources, parce que c’est une manière de reconnaître le travail, l’énergie, l’argent (ou ce qu’il faut faire pour en avoir un peu) qui est mis en jeu pour mener à bien une réflexion ou acquérir un savoir, la « mise-en-risque » de soi des personnes avant moi ; mais j’estime que cette production m’appartient autant qu’elle appartient à ma source et mon travail appartient aux autres autant qu’il m’appartient et qu’il appartient au monde. Je n’ai pas de problème de possession ou d’ego en jeu — en création comme en amour — et c’est une chance (enfin, c’est aussi une bataille permanente contre soi. C’est du travail).

Pour « Stalingrad », j’ai choisi de le faire avec Wikipedia qui illustre encore mieux ce côté « participatif » du savoir et de la création. J’ai voulu l’appliquer à la poésie. Cela rejoint aussi ma réponse précédente : on peut faire de la poésie avec n’importe quoi. « Stalingrad » est un regard posé sur une page Wikipedia. On peut poser ce même regard sur un corps comme sur un compte-rendu d’analyses médicales ou un clavier. Il suffit de s’accorder la permission de jouer.
Entretien réalisé par courrier électronique en novembre 2020. Propos recueillis par Guillaume Richez. Portrait de l’autrice © Anne-Sophie Guillet.
[3] https://revuecatastrophes.wordpress.com/
[4] https://www.terreaciel.net/Rim-Battal#.X74SqR1CcTY
[5] https://hymenredefinitions.fr/2020/05/11/loeil-des-loups-la-totale/
[6] https://femmesdumaroc.com/interview/rim-battal-le-corps-souverain-2792
[7] https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-entretien/le-grand-entretien-27-novembre-2012
C’est un très bel entretien Guillaume, qui suppose que tant l’émetteur que le récepteur ont su se mettre en phase
J’aime beaucoup et j’approuve ce qu’elle dit sur l’utilité de publier un travail incomplet pour laisser au lecteur le privilège de boucher les trous
C’est le genre d’échanges qui me motive fort pour revoir et tenter d’améliorer mes propres écrits
Merci donc
As tu lu ma chronique de « Des forêts de couleuvre/ Frontalière « , un recueil qui m’a enthousiasmé, et c’est rare
Bien à toi
Jean
J’aimeAimé par 1 personne
Cher Jean, merci ! Non pas encore lu ce recueil mais il est sur ma table.
J’aimeJ’aime