
Camille Bloomfield est chercheuse en littérature et enseignante à l’Université Sorbonne Paris Nord. Franco-anglaise, née entre les langues, elle cultive l’hybridité dans sa pratique poétique comme dans son travail en recherche et en traduction, mêlant les formes (écriture à contrainte, traduction expérimentale, poésie sonore…), et les supports (texte, vidéo, image, son, numérique). En 2014, elle a co-fondé l’Outranspo (Ouvroir de translation potencial), un collectif consacré à la traduction créative et ludique, et elle est également membre du groupe italien l’Oplepo (Opificio di letteratura potenziale), deux « OuXpo » fondés dans le sillage de l’Oulipo. Elle traduit, essentiellement de la poésie, de l’italien et de l’anglais. Elle a notamment traduit des poèmes de Yuyutsu Sharma, Henry David Thoreau et Mariangela Gualtieri.
Paolo Bellomo est libraire et traducteur. Il a grandi à Bari (Italie) en jonglant tant bien que mal entre le dialecte et l’italien de cette ville. En France depuis 2011, il a interrogé les discours de la traduction avec une thèse soutenue en littérature comparée et ne cesse de le faire en traduisant du théâtre (Emma Dante, Antonio Moresco), des romans (Célia Houdart, Antonio Robecchi, Charles Duchaussois), des vieux auteurs (Pierre Loti, Joris-Karl Huysmans) et de la poésie, le plus souvent accompagné par un.e ou plusieurs complices cotraducteu.rices. À ses heures perdues et avec un grand plaisir il écrit des pièces de théâtre et des paroles de chansons. Depuis 2021 il est membre de l’Outranspo.
En 2021, les éditions Nous ont fait paraître leur traduction à quatre mains de Cento quartine, le plus célèbre livre de la poétesse italienne Patrizia Valduga, traduit pour la première fois en français, l’occasion pour nous d’évoquer avec Paolo Bellomo et Camille Bloomfield leur remarquable travail sur cette œuvre singulière et de parler du métier de traducteur·ice.
Quand et comment avez-vous découvert Cento quartine de Patrizia Valduga ?
Camille Bloomfield : J’ai découvert Patrizia Valduga lors de mes études d’italien à Paris 3. Avec d’autres étudiant·e·s de mon cursus, nous avions participé à une lecture de poésie à l’Istituto Italiano di Cultura et j’y avais lu des extraits de Cento quartine. J’avais été frappée par la force de ces textes. J’ai ensuite décidé de faire mon mémoire de maîtrise sur un autre recueil de Patrizia Valduga, Requiem, qui est très fort aussi, bien que dans un tout autre ton.
Paolo Bellomo : La première fois que j’ai lu Patrizia Valduga j’avais 21 ans. J’avais suivi les conseils d’un ami plus jeune qui était devenu mon mentor en poésie contemporaine depuis que j’avais découvert que je pouvais aimer la poésie. Il m’avait dit qu’elle appartenait à la génération d’auteurs qui ont commencé à écrire dans les années 1980, comme Pusterla, poète que j’aimais déjà. Il était sûr que la poésie de Valduga allait me plaire. Il m’a mis entre les mains deux livres de Valduga : Requiem et Cento quartine. En obéissant à un jeu qu’on faisait souvent à l’époque, je les ai lus d’emblée et d’une traite, à voix haute. À l’époque, elle m’a surpris, désarçonné même par son adresse, sa force simple, ses vers qui tirent les formes anciennes vers l’extrême contemporain.
D’où est venue l’idée, ainsi que votre envie, de traduire ce livre ? Et pour quelle raison l’avez-vous traduit à deux ?
C. Bloomfield : J’avais envie de faire ce projet difficile, exigeant, depuis longtemps. J’avais déjà traduit quelques quatrains pour la revue L’Intranquille de l’Atelier de l’Agneau (numéro 7, septembre 2014). Mais il me manquait l’énergie pour me lancer seule dans le projet. Parallèlement à ça, nous avions envie de traduire à quatre mains avec Paolo, parce que ça nous amusait davantage. Et quand on traduit de la poésie, on n’est pas dans un souci de rentabilité, donc autant que l’on s’amuse ! Aussi, quand le nom de Valduga a émergé dans nos conversations comme une passion commune, j’ai su que le projet allait enfin se faire.
P. Bellomo : Je prenais un café avec un éditeur (pas celui qui a fini par nous publier) et il m’a demandé si j’avais des poètes·ses italien·nes contemporain·es que j’avais envie de traduire. Parmi les noms que j’ai suggérés ce jour-là, celui de Valduga l’avait emporté sur les autres. En plus je savais que Camille, qui avait déjà travaillé sur elle, voulait s’y remettre, je me suis dit que j’allais lui proposer de travailler ensemble. J’adore travailler à quatre mains, encore plus quand c’est avec des ami·es. Je suis allé la voir et elle a été tout de suite partante. En plus, lorsque nous avons commencé, nous avions tous les deux l’envie et la possibilité (c’est rare !) d’y consacrer beaucoup de temps. Travailler à deux, en partant de deux langues maternelles différentes (quatre dans notre cas) est toujours pertinent : ça ne laisse presque aucune zone d’ombre dans l’original ni dans la traduction, ça mobilise et fait interagir deux bibliothèques, ça oblige à lire les poèmes à haute voix, à avoir déjà un premier public en la personne de l’autre. Je suis convaincu que beaucoup de traductions gagneraient à être faites à quatre mains ou davantage.

Patrizia Valduga est une poétesse, également traductrice, qui jouit d’une certaine notoriété en Italie. Elle a publié une douzaine de livres, dont le premier, Medicamenta, a paru en 1982. Cent quatrains érotiques est son premier ouvrage traduit en français. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps, selon vous, pour qu’une maison d’édition française s’intéresse à son œuvre ?
P. Bellomo : Peut-être du fait que ce n’est pas une autrice consensuelle, peut-être pour la difficulté que représente sa traduction, le temps que ça demande et peut-être aussi que le marché de la poésie en France ne roule pas sur l’or. Je ne saurais pas dire.
C. Bloomfield : Oui, en effet, la poésie en traduction se vend très peu en France donc c’est toujours une sorte de petit miracle quand une poétesse contemporaine est traduite, miracle qui résulte d’un double engagement, celui de la maison d’édition et celui du ou des traducteur·ices. Là, c’est nous qui avons défendu le projet auprès de différentes maisons jusqu’à en trouver une qui accepterait de publier cette traduction.
Par ailleurs il me semble que ce recueil est celui qui a fait le plus de bruit en Italie dans l’œuvre de Valduga, qui continue à publier régulièrement. C’était en 1997, et le fait que la notoriété de celui-ci n’ait cessé de croître depuis lui donne une caution aujourd’hui, un recul qui sert d’argument en faveur d’un projet de traduction.
Patrizia Valduga a traduit Ronsard, Molière et Mallarmé. Avez-vous échangé avec elle durant la traduction de Cento quartine ? Savez-vous quel regard elle porte sur votre travail et sur cette édition française de son livre ?
P. Bellomo : Nous n’avons pas beaucoup échangé avec elle. Lorsque je traduis je préfère travailler en pensant que je traduis une œuvre plus qu’un auteur ou une autrice. Nous lui avons posé des questions concernant deux ou trois nœuds textuels à la toute fin du travail. Elle s’est dit contente de paraître en français mais ne s’est pas épanchée sur le sujet.
C. Bloomfield : Nous ne le savons pas et personnellement, je brûle de le savoir ! Si je n’avais pas traduit avec Paolo, j’aurais certainement échangé plus avec l’autrice car ce serait davantage ma manière naturelle de faire. J’avais été frustrée lors de mon mémoire à l’époque, quand mon professeur m’avait déconseillé d’entrer en contact avec elle, par crainte que je ne sois trop distraite du texte par la personne ! Comme si les deux étaient complètement dissociés ! Même si j’ai compris, en la rencontrant plus tard, ce qu’il avait voulu dire par là, je n’adhère plus tellement à cette logique purement textualiste à laquelle j’ai pourtant été formée, et aimerais être plus en contact avec l’autrice à l’avenir si je devais traduire un autre recueil d’elle, pour discuter de certains choix. Peut-être que dans cette configuration à deux, le besoin d’échanger avec quelqu’un d’autre était déjà assouvi et j’ai donc accepté de jouer le jeu de traduire plutôt sans son recours, pour voir…

Vous évoquiez plus haut votre envie de traduire ce texte à deux. Plus concrètement, comment avez-vous procédé ? Avez-vous travaillé isolément avant de confronter vos différentes versions ? Ou avez-vous traduit ces poèmes à la même table, lisant à voix haute chaque quatrain au fur et à mesure que vous les traduisiez ?
P. Bellomo : Chacun faisait de son côté, de semaine en semaine un premier jet de traduction, rien de définitif, plutôt pour commencer à voir les difficultés du poème et pour esquisser des possibilités de rimes, puis, à chaque fois nous nous retrouvions face à un document partagé et projeté sur grand écran, pour essayer de créer un quatrain français dont la rime et la métrique régulières seraient vraiment au service de la force poétique de Valduga. Bien évidemment, il y a des quatrains qui nous ont épuisé·es et sur lesquels nous sommes revenu·es des dizaines de fois.
C. Bloomfield : Le rôle de la lecture à voix haute a été très important dans cette traduction, car ce que nous avions apprécié en italien, entre autres, était la fluidité de la langue, donc il fallait qu’en français le texte « coule » tout aussi facilement à la lecture, même si du point de vue des règles de versification française, le résultat n’était pas exact. Le recueil est aussi un dialogue entre un homme et une femme, qui ont chacun des tonalités différentes, donc travailler avec nos deux voix permettait d’emblée de faire entendre et ressortir cet aspect dialogique.
Vous parlez de vos lectures à voix haute, et vous terminez également votre postface sur une invitation adressée aux lecteurs et lectrices à lire, à leur tour, ces poèmes à voix haute. Dans un entretien qu’André Markowicz m’avait accordé pour Les Imposteurs [1], il me confiait que la voix d’Anna Akhmatova avait été décisive pour lui en cela qu’il y retrouvait celle de sa grand-tante née en 1890 (« C’est une langue russe que plus personne ne parle, que personne n’est même plus capable d’imiter, et, c’est cette langue russe que, moi, j’entends toujours — dans les oreilles de la mémoire, ou celles du cœur. »). Êtes-vous particulièrement sensibles vous aussi, en tant que traducteur et traductrice, à la voix des écrivain·e·s ? Avez-vous écouté des enregistrements audio de Patrizia Valduga ?
C. Bloomfield : Oui, bien sûr, c’est magnifique de pouvoir entendre la voix des écrivain·e·s ! C’est leur corps qui transparaît dans les enregistrements sonores, et la voix est tellement porteuse d’émotion, d’histoire. Elle révèle souvent des choses de nous que l’on n’oserait jamais dire, nos fragilités, notre posture face à la vie.
Alors oui, on a écouté des enregistrements de Valduga, il y en a sur Internet et je les recommande vivement. Et puis je l’ai rencontrée, aussi, à Naples il y a quelques années, je l’ai vue en lecture et j’ai discuté avec elle ce soir-là. Sa voix de tous les jours et sa voix de lecture sont très différentes. La première est un peu traînante, déjà, et a un accent un peu particulier, certes, mais rien de choquant. La seconde en revanche est extrêmement théâtrale, d’une théâtralité assumée, outrée, ce qui est à mon sens un indice pour comprendre son travail du vers (très fin) et de la forme du quatrain dans les Cent quatrains : ils sont la transposition à l’écrit de cette littérarité extrême qu’on entend dans cette voix de lecture. Malgré le vocabulaire cru, on est très loin ici de la poésie de tous les jours, dont on ferait des posts quotidiens sur Instagram et puis, hop, tout à coup, on a un recueil !!!
P. Bellomo : Je partage l’enthousiasme de Camille pour les poète·sses qui font de la lecture à haute voix une arme poétique en plus. Comme c’est d’ailleurs le cas de Valduga. D’un autre côté, j’ai un souvenir net d’une émission télé italienne de 1989 (je l’ai découverte bien après), Aquilone, qui dans une section qui s’appelait « Poeti in gara » (« Poètes en compétition ») mettait deux poètes l’un face à l’autre, avec tirage au sort, lecture à haute voix, vote des téléspectateurs et annonce du gagnant (après quelques jours pour que les lettres arrivent à la rédaction). Je garde un souvenir terrible de ces moments, particulièrement de la lecture d’Amelia Rosselli [2] (3 min 15) et d’Edoardo Sanguineti [3] (3 min 13), deux auteurs que j’aime beaucoup par ailleurs. En les écoutant je regrettais de ne pas avoir le texte devant les yeux.
Ungaretti était un fou de la lecture à haute voix, j’adorais ses R de vieil homme lorsqu’il lisait les poèmes de Vinicius de Moraes [4]. J’ai donc une relation quelque part toujours précautionneuse à la fois à la lecture réussie et à celle prétendument ratée : je crois qu’en traduisant on doit laisser le plus de choix possibles d’interprétation non seulement textuelle mais aussi émotive, vocale d’un texte. Comme lorsqu’on traduit du théâtre. Laisser intactes les possibilités d’adresse. J’avais une lecture parfois SM, kinky, de Valduga, et je tirais la traduction vers ça, parce que je lisais ça, mais je sais aussi que je le faisais parce que Camille jouait mon garde-fou là-dessus, comme je pouvais jouer le sien en d’autres occasions, c’est le privilège du travail à deux.
Pour répondre à ta deuxième question donc, oui, j’ai écouté, j’ai passé un très bon moment en compagnie de ces sons et puis je les ai digérés : à aucun moment, je crois, notre priorité n’a été de coller à sa façon de lire à haute voix.
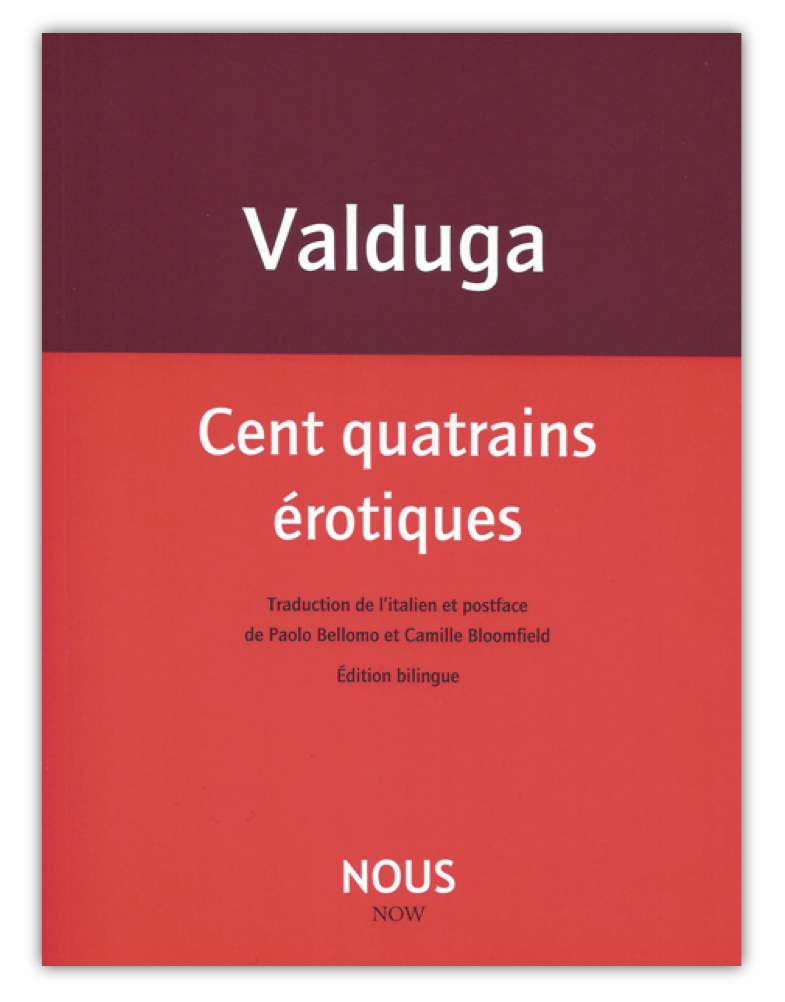
Cento quartine se compose de cent quatrains faits d’hendécasyllabes réguliers à rimes croisées. Dans votre postface, vous expliquez pour quelle raison vous avez conservé la rime croisée et choisi le décasyllabe. Dans un entretien accordé au Matricule des anges [5], Olivier Le Lay, traducteur notamment de Berlin Alexanderplatz de Döblin, ainsi que des œuvres de Peter Handke et d’Elfriede Jelinek, confiait qu’« une erreur sémantique est toujours moins grave qu’une erreur rythmique ». Même si rythme et métrique ne se confondent pas tout à fait, partagez-vous sa vision ?
C. Bloomfield : Tout à fait ! Les règles de la métrique correspondent à une prononciation du français qui n’est plus d’actualité. Elles se confondaient au départ avec le rythme, mais ce n’est plus le cas. Alors quel intérêt de favoriser la métrique si ça ne sonne pas bien, pas naturel en prononciation moderne ? Les règles de diérèse et de synérèse, en particulier, sont très complexes et personne, sauf les comédiens professionnels de formation classique, peut-être, ne les respecte plus en lecture orale. Pour le e muet, c’est plus compliqué : ça dépend d’où l’on vient. Notre français est plutôt celui de la moitié Nord de la France, donc nous ne prononçons pas vraiment les [e] en fin de mot, mais un·e traducteur·ice du Sud aurait peut-être fait différemment. Notre test, à chaque fois était de lire le vers le plus naturellement possible, et de compter combien de pieds on entendait alors. Il y a donc des irrégularités métriques, que nous assumons, mais qui facilitent en théorie le passage à l’oral de notre traduction, où le rythme devrait s’entendre plus clairement.
P. Bellomo : J’ai toujours un peu de mal à penser la traduction en termes d’erreur : c’est que la traduction est toujours vue comme fautive alors je me rends compte que j’ai naturellement arrêté de penser en ces termes-là. Les auteur·ices que j’aime inscrivent toujours un certain rythme à leurs écrits, et le rythme — j’y crois dur comme fer — est ce qui permet à leurs écrits de percuter mon attention, mon désir, mon envie. L’un des tours de la traductrice Ilide Carmignani a été de garder la flamme du rythme de Bolaño dans ses traductions. Voilà, Bolaño, le rythme en moins, reste un énorme auteur, dont le rythme de sa prosodie risque de parasiter le cerveau pendant des semaines. Tout cela pour dire que renoncer à restituer le rythme ou ne pas y prêter attention, sans être grave peut-être, reste un dommage.
Dans ce même entretien [5], Olivier Le Lay expliquait également que les traducteur·ices ne doivent rien amener d’elles-mêmes ni d’eux-mêmes, « épurer son écriture, s’effacer derrière le texte ». Et de conclure : « La pierre de touche d’une bonne traduction, c’est toujours l’épreuve du son. » Êtes-vous d’accord en cela avec lui ?
C. Bloomfield : Je suis d’accord avec la deuxième assertion (voir la question précédente) mais pas avec la première, qui correspond à un idéal de transparence un peu illusoire, à mon avis, et un peu dépassé. Bien sûr que des traducteur·ices amènent toujours quelque chose de personnel ! C’est impossible autrement. Chaque micro-décision est une part de soi que l’on amène ! Alors en prendre conscience, et objectiver cela me semble plus constructif que de prétendre que ça n’existe pas, que l’on n’existe pas. Donc il faut surtout être au clair pendant le travail avec son projet de traduction : quels sont mes choix ? Qu’est-ce que je vais privilégier, le son, le rythme, l’exactitude lexicale, le registre, la forme fixe ? Etc. Ce sont ces choix qui seront « la part de moi-même » que j’amène. Et plus ils seront osés, radicaux, plus cette part sera visible, tout simplement. En tout cas en poésie, ou pour la littérature à contrainte.
P. Bellomo : Je souscris entièrement ce qu’a dit Camille. La traduction objective n’existe pas, c’est toujours le fruit d’une lecture, une interprétation personnelle. Donc non, ne pas s’effacer derrière le texte mais servir sa cohérence, qui sera une de ses cohérences possibles, celle que les traducteur·ices auront choisi de lui donner. Pour ce qui est de l’épreuve du son, j’aurais tendance à être d’accord avec lui, ça correspond un peu aux dispositifs que je mets en place lorsque je traduis. Après il ne faut pas penser que l’épreuve du son corresponde nécessairement avec une mise en bouche sans obstacle ni aspérités. Cela ne doit pas équivaloir à un prétendu « facile à lire à haute voix ». C’est encore une fois une remarque fondamentale pour la traduction théâtrale aussi.
Dans une conférence de 1960, Ingeborg Bachmann disait : « Ce qui se fait de nouveau dans d’autres pays nous reste longtemps caché. La plupart du temps nous l’apprenons avec un retard d’une ou deux générations. » Votre traduction paraît en France plus de vingt ans après la publication de Cento quartine en Italie, ce qui semble corroborer l’assertion de la poétesse autrichienne. Si nous ne pouvons que nous réjouir de cette mise en lumière de l’œuvre de Patrizia Valduga, ne faudrait-il pas également concentrer une partie du travail de traduction sur les œuvres poétiques qui s’écrivent actuellement ?
C. Bloomfield : Bien sûr, idéalement il faut faire les deux en parallèle ! Mais les moyens alloués à la traduction de poésie par la plupart des éditeurs sont tellement réduits, il faut faire preuve d’un tel renoncement sur le plan matériel, qu’en retour, j’estime qu’on a le droit, et en tout cas je m’accorde le droit de traduire en ce domaine strictement ce que j’ai envie de traduire, sans autre considération que le plaisir ou le sentiment de nécessité d’une œuvre à transmettre au public français. Il faut se souvenir qu’en traduction de poésie, la rémunération est souvent quasi-inexistante, limitée à un pourcentage sur les droits d’auteurs et non, comme cela se fait en traduction de prose, faite d’un cumul de ces droits en plus d’une rémunération au feuillet ou au mot. De cette contrainte pécuniaire, je choisis de tirer une liberté totale dans le choix des textes que je vais proposer aux éditeur·ices.
Ainsi parfois, ce sont des textes récents, et parfois non. Paolo et moi venons aussi de la recherche universitaire, et nous découvrons les textes pas seulement au moment de leur parution en librairie, mais aussi par les travaux d’autres collègues, par des archives, par leur institutionnalisation progressive dans un champ culturel donné sur lequel on fait une veille… Cette posture n’implique pas le même rapport à la temporalité que lorsqu’on traduit à temps plein, toute l’année, des ouvrages qui font l’actualité littéraire (ce qui n’est pas du tout mon cas). Et d’ailleurs, il faudrait faire une enquête sociologique sur les traducteurs de poésie : combien sont universitaires ? Il faut avoir les moyens de se lancer dans de tels projets.
P. Bellomo : Bien évidemment il faudrait aussi se concentrer sur l’extrême contemporain. Même si je crois à une sorte de καιρός de la traduction, où la contemporanéité de telle ou telle autre œuvre n’est pas nécessairement dictée par le temps purement chronologique… Dit autrement, pour prendre un exemple récent dans le monde de l’édition française, James Baldwin est davantage notre contemporain que bien des auteurs qui ont trente ou quarante ans aujourd’hui. Mais pour éviter de m’égarer, on discutait récemment avec Camille du prochain projet de traduction de poésie ensemble et il n’est pas du tout exclu que l’on se penche de nouveau sur un poète ou une poétesse italienne vivante. Mais nous ne pouvons pas en dire plus pour l’instant.
Dans votre postface, vous écrivez que si votre traduction « ouvre la voie […] elle espère appeler d’autres traductions futures, qui feront autrement, prendront d’autres partis ». James Joyce estimait que passé « l’âge antédiluvien maximum de soixante-dix ans » une œuvre devait être retraduite, — ce qui revient à considérer que, contrairement à l’œuvre, dans sa langue originale, qui traverse le temps, toute traduction aurait une sorte de date de péremption, quelle que soit la qualité du travail des traducteur·ices. Partagez-vous cette vision ?
C. Bloomfield : Totalement. C’est quelque chose qui m’a toujours fascinée et qui dit bien qu’on traduit toujours dans une époque, selon des modes de traduction, des croyances et des discours sur la traduction qui évoluent et donc, de facto, périment. C’est ce qui fait aussi qu’il n’y a jamais « la meilleure traduction d’un tel ou d’une telle », mais « la meilleure traduction à telle époque et dans tel contexte ». La traduction, c’est du discours situé, d’une certaine manière.
P. Bellomo : Ce n’est pas étonnant que ce soit Joyce qui dise ça. Les traducteur·ices traduisent toujours vers une langue, et je souligne bien le une qui ici est moins un article indéfini qu’un adjectif numéral : on traduit une œuvre vers le français, vers l’italien, les frontières d’une langue sont là pour jouer les garde-fous du travail de traduction. Les écrivain·es ont moins ce souci, ou mieux, écrire dans une langue n’est pas une injonction explicite de leur travail. Joyce en est peut-être l’exemple le plus extrême. Et indéniablement les normes (la plupart du temps fantasmées) d’une langue évoluent beaucoup plus vite que celles autodéterminées par l’écriture d’un·e auteur·ice, qui peut être considérée comme une langue dans la langue, en deçà ou au-delà de la langue. Mais j’aimerais ajouter quelque chose : les œuvres qui ne vieillissent pas après soixante-dix ans sont celles qui deviennent quelque part des classiques et qui continuent à être lisibles parce qu’elles ont façonné ce qu’est la littérature, elles ont contribué à former les lecteurs de demain. Je crois que les œuvres qui ne sont pas entrées dans le canon littéraire vieillissent plus vite elles aussi, pas autant que les traductions peut-être, mais quand même. Ce n’est là qu’une piste de réflexion que j’aime lancer.
Quant à la démultiplication des traductions, si on pouvait faire abstraction du marché, si on pouvait être dans le pur plaisir, j’aimerais toujours qu’il y ait au moins deux traductions différentes d’une même œuvre littéraire, même lorsqu’elle est traduite pour la première fois. C’est tellement riche, la traduction.

Alors qu’en 2020, 15,9 % des livres catalogués dans les produits bibliographiques de la BnF au titre du dépôt légal sont des ouvrages traduits (l’anglais représentant 60 % du nombre total des traductions et l’italien 4 %) [6], il est encore rare aujourd’hui que le nom des traducteur·ices figure sur la couverture de l’ouvrage traduit. Parfois, leur nom n’apparaît même pas sur la quatrième de couverture. Cet usage est assez répandu en France dans les maisons d’édition, qu’il s’agisse d’un grand format ou d’un poche. Lors des rencontres en librairie, les traducteur·ices sont également rarement convié·e·s. Tout cela témoigne-t-il selon vous d’un manque de considération de ce métier propre à ce pays ?
C. Bloomfield : Oui, même si nous sommes mieux lotis en France que dans beaucoup d’autres pays d’Europe, il y a encore une grosse culture de l’invisibilité des traducteur·ices. C’est une culture souvent perpétuée par les traducteur·ices eux-mêmes, d’ailleurs, de façon largement inconsciente, dans le sens où on a tendance à se mettre en retrait, par une sorte de réflexe ancien, de posture modeste à laquelle on a été formé·es.
Mais heureusement c’est en train de changer, et de plus en plus de maisons d’édition affichent désormais le nom des traducteur·ices sur la couverture, surtout en poésie, où la part de créativité dans la traduction est plus reconnue. Je crois que c’est une histoire de temps : au fur et à mesure que les discours de visibilité se répandent dans les différents corps de métiers et que cet aspect acquiert une place plus grande dans l’inconscient collectif, j’ose espérer que ce sera bientôt systématique !
P. Bellomo : En effet, la France est plus en avance que bien d’autres pays sur ces luttes. Et ce n’est pas seulement une question de visibilité mais aussi de droits, de rémunération, etc. Mais comme tout droit acquis, il ne faut pas s’asseoir là-dessus, il faut continuer à défendre la valeur et l’importance de ce métier magnifique.
La MEET et le Collège International des Traducteurs littéraires, comme d’autres structures en France, en Belgique ou en Suisse, proposent des résidences aux traductrices et traducteurs. Votre traduction a bénéficié du soutien du laboratoire Pléiade et de la structure fédérative Medialect de l’Université Sorbonne Paris Nord. Pensez-vous que les résidences, ainsi que les aides financières à l’écriture et à la traduction sont aujourd’hui indispensables à l’exercice de cette profession ? Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaiterait devenir traducteur·ice ?
P. Bellomo : Oui, les résidences sont essentielles : elles viennent compenser une économie encore trop fragile et aident à sortir les traducteur·ices de leur solitude professionnelle, elles contribuent au sentiment de faire partie d’un réseau plus vaste et valorisé (socialement et financièrement).
Quant aux conseils à donner à des aspirant·es traducteur·ices, le plus important pour nous, qui traduisons à quatre mains, va dans le sens du collectif : il faut éviter l’esprit de compétition dans le métier et s’entraider le plus possible, en partageant les contacts des éditeur·ices, en valorisant le travail de ses collègues, en faisant des projets ensemble, en nourrissant la générosité. Il n’y a que de cette façon que cela mérite d’être vécu !
C. Bloomfield : Tellement d’accord avec Paolo, encore une fois ! Je voudrais ajouter quelque chose : en amont, notre projet a en effet bénéficié du soutien de mon laboratoire de recherche, mais il a aussi bénéficié du soutien d’un programme superbe de l’ENS (les Arlésiennes de Translitterae) [7], en partenariat avec le Collège international des traducteurs d’Arles [8], grâce à Nathalie Koble et Roland Béhar. Cela a permis une semaine de résidence & masterclass où nous avons pu, dans des conditions vraiment privilégiées, traduire de nouveau Valduga avec des étudiant·es, cette fois des extraits de Requiem, et faire une lecture finale polyphonique. On peut lire quelques résultats de ce travail collectif ici [9]. C’était un moment de partage et de transmission mémorable qui pour moi, a donné un autre sens encore à ce projet. Donc je le signale parce que je tape souvent sur l’université française et ses manques de moyen par ailleurs, mais là, je dois dire qu’on a été doublement chanceux d’avoir ce soutien institutionnel. Donc, oui, les aides sont indispensables, vitales pour ce type de projet ! Et je conseillerais à un·e jeune traducteur·ice de ne pas hésiter, surtout, à frapper à toutes les portes, à se battre pour obtenir une rémunération correcte, à multiplier les demandes de résidence, etc. C’est long et fastidieux et souvent ingrat, mais quand ça marche, quel bonheur !
Entretien réalisé par courrier électronique de novembre 2021 à janvier 2022. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photographie de Paolo Bellomo et Camille Bloomfield en une © Heiata Julienne-Ista
[1] https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2018/06/07/interview-dandre-markowicz/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=tur8Ll4vVy4
[3] https://www.youtube.com/watch?v=7N-DwBzQ0Tw
[4] https://www.youtube.com/watch?v=R373gOtqOjw
[5] Le Matricule des anges, n°188, novembre-décembre 2017, pp. 23-24.
[6] https://www.sne.fr/actu/les-chiffres-de-ledition-2020-2021-sont-disponibles/
[7] https://www.translitterae.psl.eu/arlesiennes/
[8] https://www.atlas-citl.org/conditions-de-sejour/
[9] https://www.translitterae.psl.eu/wp-content/uploads/2021/09/Arle%CC%81siennes_2_Valduga_2020.pdf
Une réflexion sur “Entretien avec Paolo Bellomo et Camille Bloomfield”