
Poétesse et artiste, Maud Thiria, née à Paris en 1973, a publié deux recueils aux éditions Æncrages & Co, Mesure au vide en 2017 et Blockhaus en 2020 (prix international de poésie francophone Yvan-Goll 2021). Elle est lauréate 2019 de la bourse de création de poésie Gina Chenouard de la SGDL pour son livre Falaise au ventre, à paraître aux éditions LansKine qui ont publié Trouée en 2022. Ses poèmes ont également paru dans des anthologies, notamment L’Éphémère — 88 plaisirs fugaces, (éditions Bruno Doucey, 2022) et Là où dansent les éphémères (Le Castor Astral, 2022), ainsi que dans plusieurs revues dont Sarrazine, Triages, Gustave, L’Étrangère, Nunc, N47, Contre-allées, Diérèse. Sa poésie, sensible, intense, puissamment évocatrice, comme les traces qu’elle dessine sur papier à main nue, recompose un travail de mémoire entre corps et paysages traversés.
Dans sa note de lecture consacrée à Trouée [1], Aurélie Foglia évoque avec une grande justesse votre adresse en « tu », « qui est à la fois une parole vers cette victime [que vous avez été], et une parole destinée à qui voudra s’y reconnaître, et y entrer par l’incitation des poèmes ». Mesure au vide et Blockhaus se structuraient déjà autour d’une adresse en « tu » plutôt qu’autour d’un « je ». Diriez-vous que cette double adresse qu’implique le « tu », constitue le mouvement premier et nécessaire de vos textes, vers vous-même autant que vers l’autre ?
J’écris en effet au « tu » qui me semble bien plus naturel qu’un « je » qui ne serait pas plus intime pour autant. Depuis « je est un autre » de Rimbaud, je pense qu’on ne peut plus vraiment dire qu’écrire au « je » serait plus intime et personnel, plus proche de soi qu’écrire au « tu » qui n’est pas seulement une forme d’adresse. Le « tu » m’est très familier, il parle de moi avec sans doute parfois une certaine distance, dont vous parlez, et en effet il englobe l’autre, qui voudra s’y reconnaître. Quand dans Trouée j’évoque l’image de la « sans visage au visage de tous » c’est dans cet esprit-là. Le « tu » peut même être parfois au masculin dans mes textes comme une forme de neutralité qui engloberait l’être humain. Évidemment le neutre n’existe pas dans notre langue et je ne rentrerai pas ici dans le débat pour ou contre l’écriture inclusive. Ce que je souhaite c’est que mon texte, aussi intime soit-il, dépasse cette intimité pour inviter l’autre à s’y reconnaître, aussi bien homme que femme car malheureusement la violence peut être subie de part et d’autre.
Ici dans Trouée, vu le contexte très spécifique, j’ai de manière évidente écrit au « tu » féminin. C’est sans doute mon texte le plus féministe puisqu’il parle de la violence subie par le fait d’un homme qui a failli m’étrangler mais au-delà de ma propre expérience je crois avoir voulu parler d’une autre violence par la négation qui est beaucoup plus globale. Une violence répétée qui sape par les mots, par les gestes, par l’absence de mots et de gestes aussi dans une forme de maltraitance.
En tout cas l’autre à qui je m’adresse est essentiel pas tant au moment de l’écriture qu’ensuite dans le partage avec les lecteurs et sur scène ou en librairie quand je fais une lecture. En cela le « tu » est partage. Pour moi l’écriture et la lecture se complètent par un échange essentiel et une oralité qui me fait du bien car elle me donne confiance en mes mots, ma voix, tout mon corps. Une sorte d’expression totale par une exposition totale.
Et puis le « tu » c’est aussi autre chose. On ne peut nier, vue l’importance de la sonorité en poésie, que le « tu », particulièrement dans Trouée, évoque, convoque même le « tu » du verbe taire et je me suis longtemps tue sur cette histoire, tout comme il renvoie au « tue » du verbe tuer forcément présent ici.
Le « tu » est donc rassembleur plus qu’un nous pour moi que je trouve souvent assez factice car il a tendance à mettre dans le même sac les autres et moi comme si nous étions liés forcément au sein d’une communauté. Les seules fois où j’ai employé le « nous », c’était dans un cadre bien précis lié à la disparition de notre espèce sur une Terre disparaissante : un couple s’enfonçant dans la vase dans un texte intitulé Nous contre dont on trouve quelques extraits sur le site de Terre à ciel [2], ou encore une humanité en marche dans le chaos du monde dans Brèche première dont des extraits sont parus dans l’anthologie sur l’éphémère publiée au Castor Astral.
Non le « tu » me va bien pour tout ce à quoi il renvoie : les autres, les autres en moi (les ancêtres, les morts que je porte en moi dans Blockhaus par exemple mais aussi toutes ces miettes de moi qui me semblent si étrangères parfois), l’empêchement à dire et à être, le tu et le tué.
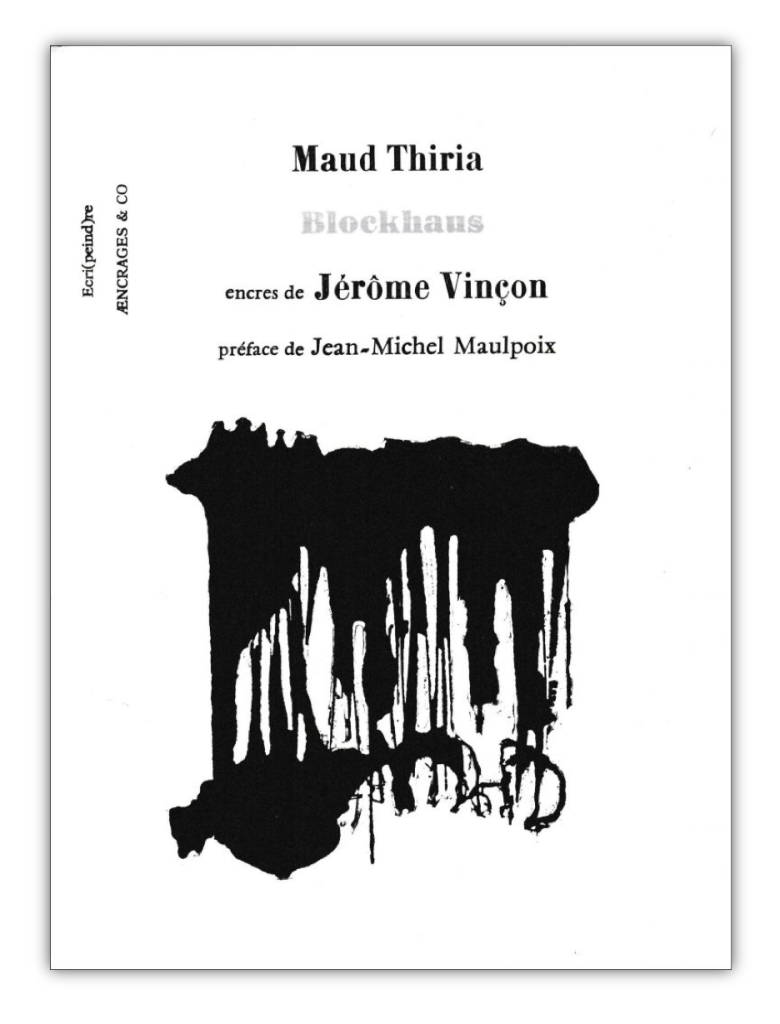
« ventre trou /cœur trou / sans plus de bouche pour / crier », écrivez-vous dans Trouée. Cette image se lisait déjà dans Mesure au vide : « rien qu’un écho / au vide / d’une bouche / seule / sans / personne ». Dans Blockhaus, nous pouvons lire : « là en langue étrangère / coincée / au fond de la gorge ». Cette parole, ou peut-être même, de façon plus primordiale, cette voix empêchée, imprègne profondément votre œuvre. Est-ce à dire que le cri est l’impulsion première du poème et que son expulsion constitue le geste vital de l’artiste et poétesse que vous êtes ?
Oui il y a bien un cri premier qui précède toute mon écriture, et peut-être même que mon écriture est tout entière sous-tendue par ce cri. C’est évidemment le cri impossible du nourrisson que je fus qui, né étranglé, n’a pas pu expulser ce cri immédiatement. Le cordon a dû être dégagé de ma gorge avant la respiration, avant le cri. Cela a sans doute joué dans ma personnalité, dans mon rapport au monde, aux autres, à l’écriture qui souvent manque, et tente de dire ce manque, de souffle dans une même respiration (ou non-respiration). J’aime dire le manque d’air initial qui m’a permis de crier un peu plus tard mais plus fort. Cette distance est sans doute celle de la femme poète que je suis, animée du juste mot, du juste son. Comme dans ma famille la communication n’est pas toujours évidente, je me suis vite sentie étrangère, à part, et je me suis vite isolée pour écrire dans une pièce à moi où je ne me trouverais ni empêchée d’être moi-même ni empêchée de crier. J’ai souvent eu l’impression de devoir crier pour me faire entendre. J’étais une petite fille très colérique et puis, plus tard, j’écoutais de la musique punk qui me défoulait beaucoup. [Rires]
Je rêve d’ailleurs d’une pièce où chacun pourrait hurler librement puis repartir calmé. On n’a pas toujours à côté de chez soi, surtout en ville, la possibilité de hurler devant la mer ou en montagne. Peut-être qu’un jour je pourrai la construire qui sait ? Cela me fait penser à ce très beau texte de Yoko Ogawa La petite pièce hexagonale qui parle de femmes qui se suivent à travers la ville jusqu’à une loge de gardien dans un parc et qui entrent une à une, chacune son tour, dans une grande armoire hexagonale, la petite pièce à raconter. Ici ce serait moins un lieu d’introspection qu’un lieu d’expulsion d’un vrai cri primal qui vaudrait, je pense, toute forme de méditation !
Évidemment dans Trouée ce cri est autre ou en écho au premier puisqu’il revient une deuxième fois étouffé. Une deuxième fois étranglée, j’ai senti dans tout mon corps que la fin était proche et pourtant m’en sortant encore une fois, j’ai senti qu’il allait falloir que je témoigne non seulement de cette violence mais de cet étouffement du cri, cette négation de soi que l’autre fait subir.

Il m’a fallu du temps pour écrire ce texte et Blockhaus est venu avant, les deux écrits se télescopant en quelque sorte, et c’est pour cela qu’il est déjà traversé de cette expérience forte du corps. En plus à cette époque le père de mes enfants après un grave accident a dû subir une trachéotomie, ce qui a renforcé l’image de la voix empêchée présente dans le livre. Et cette voix empêchée est aussi celle des secrets de famille enfouis, des non-dits au silence dévastateur, des morts du blockhaus et d’ailleurs dont je porte les voix que je tente de dire à travers moi. Briser les silences de famille et les silences de l’Histoire.
Pour revenir à Trouée, au départ il m’était impossible de parler, d’écrire sur ce vécu de maltraitance : toute voix ne pouvait que rester au fond de la gorge. Sur le moment, en 2013, ce n’est que par le corps tout entier que j’ai réussi à créer mon issue de secours. Je me suis mise à tracer jour après jour, nuit après nuit, frénétiquement, des corps, à main nue. Je n’avais jamais dessiné auparavant mais là le corps meurtri n’a pu se reconstruire que par des gestes du corps dans son entier, la main traçant un territoire à soi, reliant les miettes d’un être fracassé. C’était comme une danse sur le papier et cette danse par l’art m’a sauvée. La voix n’est revenue qu’ensuite et puis le poème a pris corps, même troué. J’ai réalisé qu’être passée par une forme d’expiration (on dit bien expirer pour mourir) m’a permis de respirer enfin.

Difficile de ne pas faire le parallèle entre Trouée et Comment dépeindre d’Aurélie Foglia (éditions Corti, 2020) [3], tant ces deux livres sœurs portent en eux les marques de la violence exercée par des hommes envers les deux femmes, poétesses et artistes, que vous êtes. Toutefois, alors qu’Aurélie Foglia a fait le choix d’indiquer la date de l’événement et de désigner l’auteur des violences (sans le nommer), vous restez évasive sur les faits, évoquant surtout le geste, — terrible —, d’étranglement, la violence extrême de l’acte lui-même, plutôt que son auteur ou la date de l’événement. Était-ce là une manière de vous protéger en séparant votre vie de votre œuvre ?
En effet nos livres sont proches en ce qu’ils expriment, en poésie, une violence subie par un homme violent avec qui chacune de nous vivait et dont nous avions pu être amoureuses. Malheureusement nous ne sommes pas les seules à être concernées par cette violence dite conjugale — que l’on soit mariée ou non — mais sans doute existe-t-il trop peu de livres qui en parlent, surtout en poésie. Ce qui rapproche Comment dépeindre et Trouée réside donc dans cette violence subie et dans la proximité de la date de parution des livres (ce qui ne veut pas dire que nous avons écrit ce texte au même moment ni même vécu les mêmes drames au même moment). Ce qui nous rapproche c’est à la fois je pense d’avoir subi cela, d’être poète et artiste, peignant à main nue qui plus est, et de nous être sentie solidaires très vite. C’est ce qui nous a poussées, sous son impulsion, à créer via les réseaux sociaux un collectif autour d’une nouvelle notion, « l’articide », basée sur le féminicide et même l’écocide. Je dirais donc que ce qui nous relie en tant que femmes incontestablement et sans doute comme deux sœurs c’est cette expérience terrible de la violence même si exercée de manière différente, que ce qui relie nos livres sans doute comme « deux livres sœurs » selon vos propres termes réside beaucoup dans l’importance donnée au geste et au corps, de la langue aux doigts, et qu’enfin ce qui nous relie en tant que femmes artistes dans notre entièreté c’est notre engagement en écriture et dans la vie.
Cela étant, je pense que nos deux livres sont très différents à de multiples points de vue, indépendamment bien sûr de la voix et du style de chacune. Pour revenir sur ce que vous nommez les faits, l’auteur des actes criminels et les dates de violence, vous dites que je reste évasive, ce qui est vrai et volontaire : je dirais que la poésie me permet cela. Si j’avais voulu raconter ces événements de violence répétée (les femmes maltraitées vous le diront — et le très beau livre de Perrine Le Querrec, Rouge pute, en témoigne — la violence n’est pas un fait unique malheureusement et se répète souvent jusqu’au féminicide), j’aurais choisi le récit. Or ici pour moi il s’agit moins de raconter que de donner voix à un corps maltraité sans voix comme sans visage, non pour me cacher ou me protéger — je m’expose à longueur de temps dans mes engagements personnels — mais pour que mon intime rencontre le plus de lectrices et de lecteurs possibles ayant subi des formes de maltraitance. Ici certes c’est de l’étranglement dont il s’agit mais c’est aussi de l’empêchement à parler, à dire et même à tout simplement exister.
Le livre est sorti en librairie en février et j’ai déjà eu des retours de femmes qui ont pu me dire à quel point mon texte les avait touchées leur rappelant par exemple leur mère face à l’alcoolisme de leur père, ou même encore d’hommes qui se sont sentis très concernés. Je crois que la poésie permet cela par sa faculté d’évocation. L’empêchement à dire et à être concerne énormément de personnes. Trop de détails n’auraient pas permis une telle identification. Trop de détails n’auraient pas permis d’atteindre une forme de temps immémorial. Et je pense que cette violence faite au corps est primitive, sans âge et sans visage. En cela elle parle malheureusement à toutes et tous.
Le deuxième point de différence je pense c’est que le livre d’Aurélie Foglia a été traversé d’un coup par cette violence et ce dès son écriture même. Le début du livre est d’une grande sensualité sur son rapport à l’écriture et au geste de peindre des arbres, et la violence vient tout dévaster d’un coup, sa vie comme son livre. C’est la grande force de Comment dépeindre de nous donner à voir la violence en train de se faire, de faire œuvre de la violence à l’œuvre. En cela, et sur beaucoup d’autres points bien sûr, c’est un livre remarquable.
Pour moi, c’est très différent. Les faits ont eu lieu entre 2010 et 2013 et j’étais bien incapable d’écrire quoi que ce soit au moment-même de cette décharge de folie qui s’est abattue sur moi. C’est donc bien après que je me suis mise à écrire ce texte et je l’ai retravaillé sur des années. Il a même eu trois autres titres avant celui de Trouée. Je pense que la distance que j’ai réussie à avoir dans ce texte je la dois à toutes ces années de deuil et de reconstruction. Alors qu’Aurélie Foglia met en œuvre cette violence qui s’immisce dans son livre au même moment que la création, je suis dans une grande distance temporelle et spatiale qui me permet de ne pas nommer lieux, dates ou personne.
Ce qui m’intéressait ici ou plutôt ce qui était vital ici pour moi à travers ce texte c’était de décrire ce que le corps ressent quand il sait qu’il va mourir. Tout se passe au niveau du corps, du ressenti physique puisqu’à la différence d’Aurélie Foglia cette destruction n’est pas passée par des toiles, vu que je ne peignais pas encore, mais par mon propre corps qui a failli à quelques secondes près ne plus jamais respirer.
Vous parlez de cette impulsion créatrice qui vous a conduite à tracer des corps humains à main nue sur le papier. J’aimerais que nous parlions de vos œuvres nées de cette énergie noire qui vous animait alors, et notamment la superbe série monochrome « Corps en rêve », réalisée à la craie sur papier de format 65 x 50 cm [4]. Nous retrouvons dans ces dessins toute l’importance du corps et de la peau, — deux motifs qui traversent vos poèmes. Dans Mesure au vide vous écrivez : « tes mots aux mains multiples / cherchant la chair / à la saisir / la perdre / dans les plis et les creux / des souvenirs ». Diriez-vous, à la suite d’Aurélie Foglia, qu’écrire vous a appris à peindre ?
Non je ne dirais pas cela parce qu’au contraire c’est dans l’impossibilité d’écrire, de trouver mots et voix, que je me suis mise tout d’un coup, de manière impulsive et vitale, à tracer ces « corps en rêve ». Je ne peignais pas avant cela. J’ai toujours adoré la peinture des autres que je collectionne en fonction de mes moyens et je me suis toujours ressourcée depuis l’adolescence dans des musées ou des galeries d’art moderne ou contemporain. J’ai beaucoup d’amis artistes et j’ai même eu la chance de rencontrer de grands maîtres comme Pierre Soulages, Zao Wou-Ki ou Vladimir Veličković. Mais si tout mon être est imprégné de dessins, de peintures ou de sculptures — ce qui se ressent peut-être dans ma poésie — je n’étais jamais passée à l’acte. C’est comme si le passage à l’acte d’une violence extrême à mon encontre avait déclenché le passage à l’acte d’une création autre en réponse. Ce fut mon arme à moi qui passait aussi par les doigts, non pour détruire mais pour créer et me guérir. Et si le corps a toujours été très présent dans mon écriture je dirais que ce n’était pas exactement au même endroit. Et qu’après cette folie meurtrière dont j’ai été victime les mots ne m’étaient plus d’aucun secours. Alors ce qui m’a sauvée cela a été de tracer ma fracture psychologique et physique sur le papier en étant au plus près du grain et au plus près de la matière.
Étrangement j’ai choisi de manière instinctive de la craie grasse qui me permettait de malaxer entre mes doigts comme de l’argile une matière qui allait m’extraire du corps enfermé où l’on m’avait mise. C’est très calmant vous savez d’avoir entre les mains une matière à écraser, à concasser ou à pétrir comme je pouvais le faire enfant avec du brou de noix ou en jardinant avec mon grand-père. La terre a cet effet là sur moi de me calmer quand je la touche, la malaxe, la ressens à travers tous mes sens. J’imagine que pour les sculpteurs l’argile, entre autres matières, doit avoir un effet assez proche.

J’y ai trouvé par ce geste une nouvelle énergie que je ne dirais pas noire car elle était une réponse à la noirceur. Certes la craie grasse utilisée était noire ou très brune mais j’ai toujours aimé cette non-couleur qui permet de jouer avec la lumière. Et puis ces corps je les ai nommés « en rêve » non en cauchemars ! Et ce terme de « en rêve » avait pour moi plusieurs significations. Sans doute il me rendait le pouvoir de l’imaginaire, mais il m’offrait une nouvelle matière comme on dit « en or » ou en « pierre ». La matière du rêve que l’on cherche sans doute toujours. Rendue à ma solitude et ma déchirure, tous ces êtres fantomatiques, bancals, ou fièrement debout malgré tout m’ont repeuplée, réparée, rendue au monde des vivants.
© Maud Vinçon, Corps en rêve, craie sur papier, 65 x 50 cm. Œuvres protégées par l’ADAGP.
Dans Mesure au vide vous écrivez « ce n’est pas le même outil / que tu tiens / c’est ton encre / qui coule au monde », tandis que le premier vers de Trouée est « ici coule au noir ». Vos dessins, que vous appelez des « traces », laissent souvent apparaître le geste même de votre main traçant de haut en bas sur la feuille des silhouettes de créatures qui se tiennent debout. S’agissait-il pour vous de reproduire ce mouvement intérieur de coulée, de chute, comme s’il fallait représenter à la fois, et paradoxalement, l’effondrement de l’être (sa chute) mais toujours debout ?
J’aime les paradoxes parce que toute la vie en est pleine, en déborde même. Et la poésie est sans doute la forme qui me permet de saisir cet impossible « tout » qui regorge de tout et son contraire.
Votre question me fait tout de suite penser à l’apoptose qui est la mort programmée contenue dans chaque cellule de vie. Apoptose vient du grec apo « au loin » et ptosis « chute », apoptosis étant la « chute des feuille ». Je m’intéresse de près à la biologie cellulaire et ce mot a beaucoup de sens pour moi parce que s’il renvoie au départ aux feuilles des arbres qui doivent nécessairement tomber pour qu’un cycle de vie puisse recommencer, il évoque aussi les feuilles de papier qui sans doute aussi doivent contenir la chute des mots pour en permettre le poème. Tout est lié et l’on sait que chez un être vivant multicellulaire, si les cellules ne meurent pas il y a prolifération et maladie dont le cancer.
Paul Celan disait « vois comme ce qui t’entoure devient vivant —
Près de la mort ! Vivant !
Qui parle l’ombre
parle vrai. »
Alors oui, je crois avoir trouvé dans cette forme de mort vécue la force de vie qui est la mienne aujourd’hui. Et c’est ce que je tente de dire en poésie, « parler l’ombre ». Toute chute porte un renouvellement, toute coulée une source d’origine. Si dans Trouée j’évoque cette coulée au noir, j’y convoque aussi la vision d’un oiseau en vol. Si j’évoque la chute, je convoque aussi l’arbre qui « abrite la proie ».
Pour revenir aux traces de corps que je fais, en tout cas celles dont vous parlez les « corps en rêves » longilignes et noirs, elles semblent en effet debout mais à regarder de plus près je crois qu’elles sont aussi très bancales, silhouettes penchées vers le vide. Et là je ne peux m’empêcher d’avoir à l’esprit L’Homme qui penche de Thierry Metz que j’aime tant. Aujourd’hui, en ce qui me concerne en tout cas, je ne crois pas qu’il soit possible d’écrire autre chose qu’une poésie bancale (c’est d’ailleurs le titre d’une série de poèmes et dessins que l’on peut voir sur le site Myowndocumenta [5]).
Ces silhouettes sont aussi très poreuses comme emplies de failles, ces mêmes failles qui fragilisent mais laissent aussi passer la lumière. Elles représentent en quelque sorte la perte et ce que l’on en fait dans un même mouvement, le perdu et le façonné.
Ce que vous dites sur la représentation paradoxale de l’effondrement et du debout me plaît beaucoup. C’est exactement cela, ici et là, dans l’art que je fais comme dans la nature, qui m’intéresse. Dans les paysages que j’aime, que je traverse et qui me traverse, ceux des falaises sont sans aucun doute ceux qui me parlent le plus. Des Roches noires aux falaises de la Hague du Cotentin aux falaises crayeuses d’Étretat, toutes font écho à mes voix intérieures. Elles déclinent toutes ce paradoxe de l’extrême blancheur du calcaire du Pays de Caux à l’extrême noirceur argileuse du Pays d’Auge, d’une mémoire ancestrale avec les fossiles réputés des Vaches noires vers Houlgate au renouveau lié à la perte avec les chutes de roches successifs. Elles parlent de cet effondrement (elles tombent dévorées par la mer d’un côté et rongées de l’intérieur par des infiltrations d’eau) mais aussi de cette force verticale d’être debout face à la mer. On ne peut que ressentir cette force quand on passe dessus et dessous et également cette fragilité qui les menace tout en promettant aussi leur renouvellement.
Les « corps en rêve » parlent de cela je pense, de corps comme de paysages qui s’effondrent attaqués de l’intérieur comme de l’extérieur et qui pourtant malgré tout dans l’ombre et avec cette ombre (d’ailleurs une des craies que j’utilise a pour nom de couleur terre d’ombre) continuent de se tenir debout.
Je crois que l’on ne tient que lorsqu’on connait son fragile équilibre. On fait avec et on tente, en poète et en artiste, d’en témoigner au mieux, même bancale. Surtout bancale.

Vous dites convoquer dans Trouée la vision d’un vol d’oiseau et l’on pense à la photographie de Véronique Lanycia qui illustre la très belle couverture de votre livre. Mesure au vide et Blockhaus étaient illustrés par les encres de Jérôme Vinçon et vous avez réalisé des livres pauvres avec plusieurs artistes, notamment Elisabeth Bard, Aaron Clarke, Daphné Bitchatch ou encre Jean-Michel Marchetti. Il me semble que l’attention que vous portez à l’illustration va au-delà de la simple volonté de produire un bel objet agréable à regarder. Comment s’articule, dans la création d’un livre, votre rapport entre l’illustration et l’écriture ? Écrivez-vous à partir d’œuvres existantes ou les œuvres ont-elles été créées d’après vos textes ?
Pour mes livres de poésie je n’écris jamais à partir d’une œuvre, dessin, encre, peinture ou photographie. Le texte préexiste donc. Il s’écrit dans l’espace-temps qui est le sien et qui diffère d’un texte à l’autre.
L’image dont je parle dans Trouée est purement une image salvatrice, propre au texte et à l’expérience de maltraitance du corps qu’il évoque, de celle que l’on peut percevoir en une dernière vision avant le noir de la fin. Ici ce sont des oiseaux dans les pins qui piaillent et volent comme concentrant en eux tous mes sens atrophiés, oiseaux qui me viennent comme certains disent voir leur vie s’écouler avant de mourir. Chacun ses remontées. Et donc la photographie n’était pas du tout présente au moment de l’écriture du texte.
Quand j’ai proposé mon manuscrit aux éditions LansKine, il a été accepté tel quel et je n’étais pas obligée de choisir un artiste pour la couverture puisque certaines comportent seulement le « logo » et la ligne caractéristiques de la maison. Je cherchais une couverture sobre qui aurait pu être sans une œuvre particulière, il se trouve que je suis tombée par hasard sur une photographie de Véronique Lanycia aperçue sur Internet grâce à la poète Frédérique Germanaud. Cet oiseau en vol, un corbeau noir, qui frôle l’abstraction m’a tout de suite parlé. Il était pile car il correspondait à la fois à la « vision » décrite dans le livre et au trou qu’il figure presque dans un mur. Beaucoup de lecteurs ne voient d’ailleurs pas qu’il s’agit d’un oiseau et imagine tout autre chose. C’est tout le talent de Véronique Lanycia d’avoir saisi un instant d’envol révélant autre chose qu’un simple envol. En cela il entre en résonance forte avec mon texte où l’oiseau est présent tout en étant comme fantasmé puisqu’entraperçu dans une dernière vision.
Ici la photo existait indépendamment du texte et le texte indépendamment de la photo et quand j’ai proposé à Véronique de faire de sa photo la couverture de Trouée j’ai eu la chance qu’elle accepte, qu’elle aime mon texte et puis que Catherine Tourné, mon éditrice, aime son travail de photographe et trouve, elle aussi, que texte et photographie correspondent parfaitement.
Pour les éditions Æncrages & Co, c’est un peu différent puisque cette maison fait toujours coexister un auteur et un artiste. Ayant repéré, au Marché de la poésie Place Saint-Sulpice puis au Salon de l’Autre Livre, la beauté de leurs ouvrages encore faits à la main et la qualité de leur catalogue, j’ai décidé de leur envoyer mon premier manuscrit Mesure au vide avec une encre de Jérôme Vinçon que je souhaitais avoir comme compagnon de livre. L’éditeur ayant donné son feu vert, l’artiste a lu et relu mon texte et après une lente imprégnation il en a réalisé les encres en écho aux impressions ressenties alors. Pour le deuxième livre, j’avais choisi de travailler de la même manière et avec le même artiste. J’ai même eu le choix du format qui correspond à la collection Écri(peind)re car pour Blockhaus j’imaginais un format assez large quasi en bloc carré qui corresponde bien au texte. Chaque page forme comme un petit bloc dans le grand bloc du livre et du « bloc d’os ».
En cela il s’agit d’un accompagnement plus que d’une illustration, terme que je n’aime pas tellement. Ensemble nous avons réalisé ce livre, moi côté texte et lui côté encres et d’ailleurs ce livre vient d’être sélectionné pour un prix de livre d’artiste ce qui montre bien qu’il dépasse la simple écriture déjà primée par le prix Yvan-Goll.
En ce qui concerne les livres pauvres cela peut être assez différent même si en général le texte préexiste, qu’il soit de moi accompagné d’une réalisation d’un artiste ou qu’il soit d’un autre poète accompagné par l’une de mes « traces ». C’est en fonction de chacun. Il y a une grande liberté dans le livre pauvre puisqu’il n’y a pas d’éditeur. Les artistes et les auteurs se choisissent, ou sont mis en relation par Daniel Leuwers, et œuvrent ensemble autour d’un thème, commun à d’autres et donné par l’inventeur du « livre pauvre ». Cette liberté permet à chacun de voir ce qu’il préfère entre un texte préalable ou une réalisation artistique préalable.
Nous avons abordé la voix empêchée, et j’ignore s’il existe un lien direct, mais je remarque qu’il y a en vous une volonté affirmée de lire vos textes en public. Est-ce important pour vous de sortir du livre et de sa solitude — la vôtre, en tant qu’autrice, mais aussi celle qu’induit l’acte de lecture pour les lecteurices —, de créer un autre rapport entre le texte et les lecteurices, d’aller vers le collectif ?
Au départ je ne pensais pas lire mes textes en public. Il s’agit d’abord d’écrire et en effet dans la solitude et je rajouterai même dans le silence en ce qui me concerne. J’écris dans un silence total car j’ai besoin d’entendre ma voix intérieure, la musique qui m’habite au moment où j’écris. On me dit souvent que mes textes sont assez chantants, possèdent une musicalité particulière faite de rythme, de répétition tournant parfois à la ritournelle et c’est sans doute vrai mais non sciemment recherché. Ce rythme propre à ma voix poétique lui est inhérent et vient naturellement à l’écriture. Ce qui ne veut pas dire que je ne retravaille pas mes textes après coup pour accentuer un rythme ou au contraire le couper.
J’ai découvert peu à peu que la lecture à voix haute et en public, même celle d’un texte plutôt écrit ou en tout cas non écrit spécifiquement pour la lecture publique avec une forme d’oralité prévue initialement, m’apportait beaucoup. En effet j’ai pris confiance en ma voix, cette voix empêchée et souvent tue, une voix que je n’appréciais pas à l’entendre et que j’ai appris à aimer. Aimer sa voix, son corps ne va pas de soi et les autres m’ont beaucoup aidée à franchir certains blocages, guérir certains handicaps. Je pense à ceux qui ont pu me demander de lire à voix haute ou d’enregistrer ma voix pour des textes d’autres poètes ou les miens : Les Imposteurs pour la chorale de femmes autour des livres de Perrine Le Querrec Rouge pute [6] ou d’Aurélie Foglia Comment dépeindre [3] ; également le SVP (Serveur Vocal Poétique) développé par Julien Bucci et qui permet d’écouter 51 poèmes lus par leurs auteurs ou des comédiens en composant gratuitement un numéro de téléphone (03 74 09 84 24), initiative que je salue ici. Je pense aussi à ceux qui m’ont invitée à faire une lecture performance qui m’a fait réaliser à quel point j’étais bien sur scène, qu’en fait j’adorais cela !

Par cette autre manière de partager mes textes, je me suis rendu compte qu’en fait (même si cela peut paraître évident en soi) le livre existait réellement, pleinement je dirais, par le rapport étroit qu’il entretient aux autres, lecteurs et/ou auditeurs, rapport secret quand il est lu chez soi et rapport plus ouvert quand il est lu à voix haute en public. La relation au lecteur qui est parfois également auditeur donne sa vraie dimension au livre, elle le poursuit en quelque sorte, le prolonge. L’autre donne en effet une autre dimension au livre par ses notes de lecture quand c’est à l’écrit qu’il correspond, par ses questions, par son écoute et ses réactions quand c’est en public qu’il entre en relation. En public on est dans l’immédiateté et beaucoup de choses sortent. C’est passionnant de voir en direct, en présence, les réactions des lecteurs auditeurs. Que ce soit dans des lieux d’accueil privilégiés comme les lieux culturels, librairies, expositions, médiathèques, mais encore dans des lieux où l’on n’est pas forcément attendu comme les lycées où rencontrer un poète vivant est une expérience souvent incroyable ou encore l’hôpital et la prison où les échanges sont essentiels, autrement essentiels.
Je ne sais pas si la lecture publique est une forme de réponse à cette voix empêchée mais il me semble qu’elle invite les lecteurs et auditeurs à ne pas s’empêcher de voir, d’écouter et de dire, qu’elle les invite au non-empêchement en les incitant parfois même à écrire. Je dirai de la lecture publique que plus qu’un pas vers le collectif c’est un pas vers une humanité partagée, celle de l’empêchement partagé, d’une solitude partagée.
Il est un autre aspect de votre parcours de poétesse que je souhaiterais aborder, à savoir votre engagement pour plusieurs causes, engagement qui n’a rien d’anecdotique. Vous évoquiez précédemment la création avec Aurélie Foglia d’un collectif autour de la notion d’articide. Et je pense également à vos actions en faveurs des femmes et poétesses afghanes, et notamment à la lecture musicale, que vous avez organisée à la Maison de la poésie de Paris en septembre 2021, qui réunissait Husnia Anwari, journaliste franco-afghane et poétesse féministe, et Belgheis Alavi, enseignante chercheuse à l’Institut national des langues et civilisations orientales, accompagnées du musicien Kengo Saito, et aussi de nombreuses poétesses dont Laurence Werner David, Rim Battal, Zoé Besmond de Senneville, Marie-Hélène Archambeaud, Sanda Voïca, AC Hello, Julia Lepère, Orianne Papin, Virginie Poitrasson et Anne Savelli [7]. Il me semble que cet engagement, et les actions que vous avez initiées, sont consubstantiels de votre démarche d’artiste et de poétesse. Je me trompe ?
Tout est lié en effet. Et si je prends position contre toute forme d’empêchement à dire ou à être par les actions que je mène cela rejoint forcément mon écriture.
Et puis il y a des hasards de rencontres et je crois beaucoup à cela ou plutôt je m’interroge sur le pourquoi de telles rencontres. Je prendrai comme exemple les vacances que j’ai passées l’été dernier dans les Alpes. Je logeais dans une maison près de la vallée de la Clarée, le temps comme les paysages étaient magnifiques et puis tout d’un coup quelque chose s’est assombri. Comme toutes et tous, le 15 août, j’ai assisté à l’arrivée au pouvoir des talibans. Comme toutes et tous je me suis sentie impuissante. Mais il y avait quelque chose de plus fort en moi ou autour de moi qui me poussait alors à agir, ce que j’ai fait immédiatement en rentrant à Paris. Je ne suis pas d’origine afghane, je n’ai, enfin je n’avais pas alors, d’amis afghans, tout au plus d’anciens élèves de l’époque où je donnais des cours de FLE à Aubervilliers à des migrants et des réfugiés politiques. Et pourtant quelque chose de très fort me poussait à agir. Au départ j’ai pensé, et je crois toujours que c’est l’une des raisons sinon la principale de mon action, que c’était cet empêchement des femmes à vivre librement, à s’exprimer, à exister qui m’ordonnait presque à parler en leurs noms. Et puis en organisant cet évènement à la Maison de la Poésie et en invitant mon oncle et ma tante qui travaillent depuis des années pour des associations culturelles et humanitaires, j’ai compris ce que le lieu dans les Alpes, leur maison de vacances, m’avait inspiré. Ce sont eux qui avaient hébergé dans cette même maison l’une des Afghanes présente sur scène, sans doute dans la même chambre que celle où j’avais dormi. Je crois que cela a joué un rôle dans mon engagement, même sans le savoir. Je crois en la mémoire des lieux, en ce qu’ils impriment en nous. C’est mon côté médium. [Rires]
Et puis je crois en l’effet boule de neige des actions. Cette soirée a été l’occasion de réunir des poètes que pour certaines je ne connaissais pas personnellement et qui ont toutes répondu présentes (je les en remercie encore ici !), ce qui nous a permis de nouer des liens autres et forts. Cet événement a pu donner envie à d’autres personnes de se mobiliser ailleurs en France. Je pense notamment à toutes les actions que la poète Estelle Dumortier a organisées. C’est formidable de voir qu’une action préparée dans l’urgence et qui peut sembler dérisoire face à une situation politique et humanitaire dramatique a pu connaître de tels retentissements. Non seulement on faisait parler des voix tues voire tuées mais en plus on permettait à des éditeurs de prendre conscience du manque de textes publiés en France de cette poésie si essentielle.
Cette soirée a été dans sa préparation et dans ses suites une source incroyable de rencontres humaines très fortes. Non seulement j’ai été accueillie comme une sœur par toutes les femmes afghanes qui par la suite m’ont invitée à des évènements publics mais aussi d’ordre personnel et privé suite au massacre de certains membres de leur famille, encore à Kaboul, par les talibans. Mais j’ai aussi été accueillie par un milieu culturel fait de chercheurs, de journalistes, de diplomates, de cinéastes, de traducteurs, qui m’ont invitée à participer à des débats, des lectures, des festivals autour de l’Afghanistan. Et alors que l’on ne trouvait presque aucun poème afghan en France, traduit ou en langue originale en dari ou persan et très peu en pachtou, ce qui avait rendu laborieuse l’organisation de la lecture sur la scène de la Maison de la Poésie, tout d’un coup deux anthologies vont voir le jour ! Une était presque finie, établie et traduite par Leili Anvar, qui va sortir en mai chez Bruno Doucey, Le Cri des femmes afghanes, grâce auquel nous avons pu lire des textes en septembre dernier. L’autre est à l’initiative d’un ancien grand reporter et écrivain ayant beaucoup travaillé en Afghanistan et qui, présent dans la salle en septembre, m’a tout de suite contactée pour mener ensemble cette aventure de créer une anthologie de poésie afghane qui se distingue de celle de Bruno Doucey puisqu’elle rassemble uniquement des poètes contemporains vivant encore à Kaboul ou exilés à travers le monde. Elle est établie et traduite par deux traductrices Belgheis Alavi et Guilda Chahverdi et sortira sans doute en septembre.
L’empêchement à être et à dire m’enjoint aussi à agir dans d’autres milieux et pour d’autres causes. Ma résidence à l’hôpital l’an dernier était dans cette lignée puisque son intitulé était « Il n’empêche ». Les interventions que je commence en maison d’arrêt à Fleury-Mérogis poursuivent également ce travail autour de la parole et du corps entravés. Comment dire détenu ?
Et puis j’ai d’autres projets autour de la malvoyance avec une photographe pour les années à venir afin de travailler sur un autre regard.

Deux de vos poèmes inédits sont publiés dans les anthologies L’Éphémère — 88 plaisirs fugaces, établie par Thierry Renard et Bruno Doucey (éditions Bruno Doucey, 2022), et Là où dansent les éphémères, établie par Jean- Yves Reuzeau (Le Castor Astral, 2022), deux anthologies qui réunissent les textes de nombreux poètes et de nombreuses poétesses, avec quelques rapprochements parfois assez surprenants tant certains univers, personnalités et esthétiques peuvent se révéler antagonistes. Au-delà des clivages qui existent dans le milieu de la poésie, cela vous paraissait important que vos textes soient publiés dans ces deux anthologies ? Ne pensez-vous pas qu’il y a un risque de nivellement, voire d’illisibilité, mais aussi le risque de passer sous silence certains courants poétiques plus marginaux et des écritures plus radicales qui sont en train d’émerger ?
J’adore les anthologies. C’est ainsi que j’ai découvert la poésie. Mon père m’offrait quand j’avais 7-8 ans des livres par thématiques en folio qui regroupaient plein de poètes hommes et femmes de siècles divers. Cette variété de tons, de voix, d’univers a nourri ma sensibilité, affiné mes goûts. Je les ai gardées et m’en sers de temps en temps pour des ateliers d’écriture quand je travaille sur des thématiques comme la ville, le rêve, la mer, le voyage. J’aime y retrouver des points ou des croix montrant mes premiers goûts en poésie qui ne sont plus forcément les mêmes qu’aujourd’hui. Ce que j’aime dans une anthologie, et justement quand elle est particulièrement variée, c’est la possibilité de faire ses choix, de trouver des échos, des frères ou des sœurs en poésie, et puis ensuite d’aller acheter leurs livres pour approfondir ce que l’on a découvert, entraperçu de leur voix.
À chaque fois que j’ai participé à une anthologie cela a été une vraie rencontre. D’abord Florence Saint-Roch m’a demandé de faire partie d’anthologies qu’elle coordonnait sur le site de Terre à ciel et j’ai découvert plein d’auteurs que je ne connaissais pas avec qui j’ai eu envie de travailler ensuite. Puis un éditeur m’a demandé de faire partie d’une de ses anthologies parce qu’il m’avait vue seule debout sur la place Saint-Sulpice à résister contre vents et marées aux annulations successives du Marché de la poésie.
Pour revenir aux deux anthologies dont vous parlez autour de l’éphémère, c’est la première fois que je participe à ces anthologies du Printemps des Poètes. Cela s’est encore fait par le hasard des rencontres, un texte donné suite à une lecture d’un auteur dans une librairie, un autre demandé par l’éditeur. Les deux textes inédits sont très différents aussi bien dans l’écriture que dans le sujet qu’ils donnent à voir. L’un chez Bruno Doucey se situe dans la ligne de Trouée autour du cordon et du cri, l’autre au Castor Astral fait partie d’un recueil, Brèche première, que j’avais en partie lu lors d’un festival autour de la disparition de la Terre et de notre propre espèce. Apocalypse personnelle vs apocalypse universelle. Vus mes textes et mes recherches, je devais assez bien correspondre à ce thème de l’éphémère puisque ces deux éditeurs très différents ont choisi de me faire une place parmi tant d’auteurs bien plus illustres que moi.
J’aurais donc plutôt tendance à saluer dans les anthologies en général et dans ces deux-là en particulier la richesse dans la diversité de tons et de voix puisqu’elles regroupent une centaine de poètes chacune environ, de courants différents. On y rencontre aussi bien des voix de femmes que d’hommes, plus classiques ou plus radicales et modernes. Après, on peut sans doute regretter que certains n’y soient pas mais là c’est le choix de l’éditeur. C’est à lui de lui poser la question ou de lui reprocher ses choix ! [Rires.]
Votre prochain livre, Falaise au ventre, est à paraître chez LansKine. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui mon prochain livre de poésie paraîtra aux éditions LansKine l’an prochain. Falaise au ventre a eu la grande chance d’être lauréat de la bourse Gina Chenouard en 2019 qui m’a bien aidée à l’écrire surtout en temps de Covid et de chômage. Terminé en 2020, il devait sortir au départ chez un autre éditeur qui en a publié des extraits (15 poèmes) dans sa belle revue L’Étrangère n°51-52 où j’ai la chance de côtoyer Laure Gauthier, Esther Tellermann et Florence Jou notamment. Malheureusement le Covid passant par-là, l’éditeur a connu quelques difficultés et comme à présent je suis autrice chez LansKine il est devenu évident qu’il serait publié là. Ce qui me réjouit !
Pour ce qui est du sujet comme son nom l’indique il y est question des falaises, paysages que je parcours depuis une dizaine d’années du côté du littoral normand, comme je l’ai évoqué plus haut, pays de cœur comme on dit. On aime les paysages qui nous ressemblent et j’en parle dans un de mes articles sur remue.net autour de la dévoration, « Dévoration – Infiltration » [8]. La relation corps-paysage est toujours bien présente dans mon écriture, ce qui m’a valu d’intervenir en école d’architecture pour un séminaire du laboratoire de recherche « Architecture, Milieu et Paysage », lors d’une présentation portant le tire « Falaise au ventre ». C’était passionnant comme tout échange qui dépasse une discipline. J’aime pouvoir travailler avec des chercheurs, des scientifiques, des artistes et des artisans œuvrant dans des domaines multiples. Cette richesse de rencontres d’humains et d’univers, souvent séparés à tort et pas forcément amenés à collaborer, offre une vraie ouverture à ma poésie vers des contrées qu’elle n’imaginait pas.
Pour revenir à ce prochain livre de poésie chez LansKine, le corps fait bloc avec le paysage, il est comme pris dans la falaise y enfantant des mots, y attendant un renouveau possible en se remémorant des temps anciens pour des mutations futures.
Je dois le titre à un autre grand amoureux, et bien avant moi, des falaises, le poète Jacques Moulin qui, alors que je lui envoyais une photo de falaises des Roches noires très escarpées, en creux, m’a répondu « falaise au ventre ». Ces mots ont tout de suite résonné en moi et m’ont invitée à écrire un recueil. Parfois un titre inspire tout un texte. Il en a été ainsi et je lui ai dit, lui demandant si je pouvais utiliser ses propres mots pour titre, ce qu’il a accepté. J’ai lu bien plus tard ces mêmes mots dans un de ses très beaux livres épuisé malheureusement, Escorter la mer. Je vous invite à lire la poésie des falaises et des valleuses de ce poète du pays de Caux où la blancheur crayeuse répond en écho au noir de mes roches.
« J’ai la falaise au ventre. J’y passe la main râpage de lèpre et chair de poule une boursouflure qui ronge la falaise par pans entiers avant la chute. Craie glauconieuse saturant la bonne mine jusqu’au vomissement.
J’ai la falaise au ventre. Sa peau déchire mes veines dans la nuit des silex. » (Jacques Moulin, Escorter la mer, éditions Empreintes, 2005)
Évidemment Falaise au ventre commence par une citation d’un de ses poèmes et également par celle d’un autre poète découvert sur le tard dont l’écriture a une force rare, Franck Venaille et sa Descente de l’Escaut.
Pour le reste je vous laisse découvrir le texte l’an prochain !
Entretien réalisé par courrier électronique de février à avril 2022. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photographie de l’autrice en une © DR – La Factorie Maison de poésie Normandie, janvier 2022
[1] https://www.sitaudis.fr/Parutions/maud-thiria-trouee-1643694674.php
[2] https://www.terreaciel.net/Maud-Thiria#.YlWCgh06-D4
[3] À écouter dans Les Imposteurs, la lecture chorale de poèmes extraits de Comment dépeindre lus par Rim Battal, Vanessa Bell, Katia Bouchoueva, Sara Bourre, Aurélie Foglia, Amélie Guyot, Mélanie Leblanc, Lisette Lombé, Florentine Rey, Marine Riguet, Maud Thiria et Milène Tournier : https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2021/02/26/comment-depeindre-daurelie-foglia-audio/
[4] https://thiriavinconblog.wordpress.com/series/test-corps/
[5] http://www.myowndocumenta.art/maud-thiria/
[6] https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2020/06/16/rouge-pute-de-perrine-le-querrec-audio/





