
Le titre de votre dernier recueil publié chez LansKine, Transport commun [1], avec la polysémie du mot transport (je pense à l’expression « transport amoureux »), me semble faire écho à votre démarche vis-à-vis de la poésie qui consiste à sortir du cliché de la poétesse solitaire écrivant pour elle-même. L’idée était-elle d’affirmer que la poésie, ou du moins votre poésie, est l’affaire de toutes et tous, un bien commun, un moyen de voyager ensemble ?
Absolument. De la même manière que ce titre qui permet à des poèmes de formes très diverses de faire recueil aussi, il nous permet de feuilloler ensemble autour d’une même branche. Poser un même regard, si cela est possible, je veux dire physiquement même, sur un envers du décor qu’il soit celui de l’amour que peut éprouver une mère pour son petit bébé sans vouloir le posséder, sans le penser comme une extension de sa propre humanité, poser un regard autre sur Tanger (Zone franche), ville sublimée par toute une génération d’auteurs ou cinéastes qui y ont séjourné ou tourné, pour qui cette ville était le théâtre et la matière d’une histoire personnelle. On apprend beaucoup plus sur Burroughs — puisque vous en parlez — en allant à Tanger que sur Tanger en lisant Burroughs. Je ne dis pas que l’écrivant doit quoi que ce soit à qui que ce soit — il ne manquerait plus que — ça, je dis juste que j’apporte un petit déplacement, une brèche dans les rails qui permet une bifurcation si on veut bien la prendre avec moi.
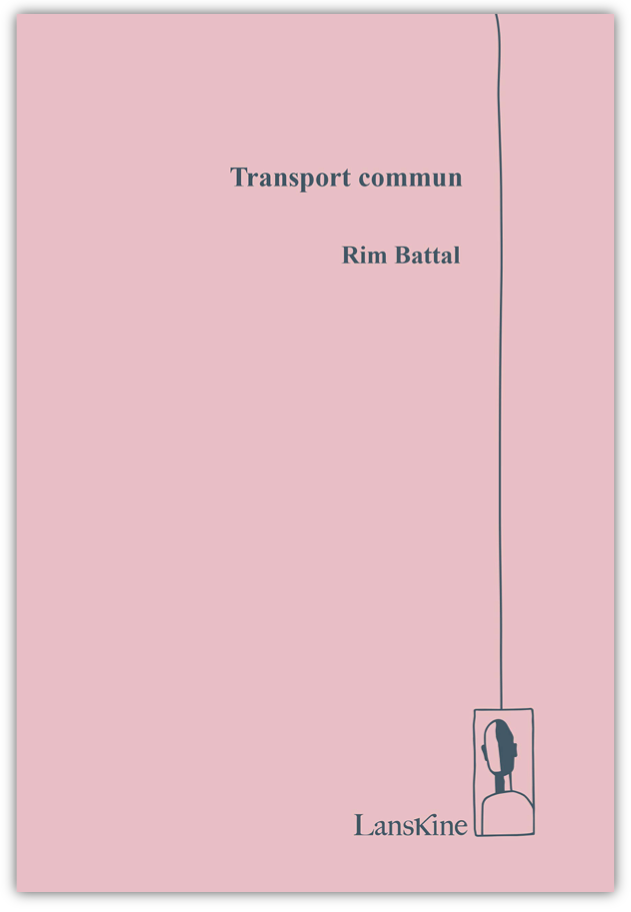 Le premier poème a pour titre « Madame ; ». Je prends ce point-virgule pour un clin d’œil, un signe transfuge des textos. Importer dans votre recueil ce signe de ponctuation, détourné de son usage premier pour signifier un clin d’œil, était-ce une façon pour vous de montrer que rien dans votre écriture n’est proscrit et que la poésie doit puiser dans les usages populaires quels qu’ils soient ?
Le premier poème a pour titre « Madame ; ». Je prends ce point-virgule pour un clin d’œil, un signe transfuge des textos. Importer dans votre recueil ce signe de ponctuation, détourné de son usage premier pour signifier un clin d’œil, était-ce une façon pour vous de montrer que rien dans votre écriture n’est proscrit et que la poésie doit puiser dans les usages populaires quels qu’ils soient ?
Quand on prend le temps de réfléchir, se documenter, contempler, questionner pour écrire pour l’autre, avec l’autre, rien ne devrait être proscrit en principe. Nous vivons dans un monde hyper-complexe en disposant de 5 sens et d’une intelligence très relative. C’est une lucarne vraiment ridiculement minuscule. Si en plus on se mettait des règles et des contraintes dès qu’on voulait transmettre le moindre mini truc, on ne s’en sortirait pas. Pour atteindre l’autre, il faut aller chercher les signes ou symboles ou références communes là où elles sont. Les règles et contraintes sont censées nous aider à accoucher pas de nous cockbloquer.
Allons plus loin : croyez-vous que la lecture sur smartphone, liseuses et autres tablettes conduit à de nouvelles formes d’écriture, de nouvelles esthétiques ?
Bien sûr mais sans rendre les anciennes illisibles ni leur enlever de leur intérêt. Hormis le fait qu’elles permettent d’ajouter éventuellement musique, vidéo, emojis (qui doivent pouvoir augmenter une écriture et non pas l’appauvrir si c’est utilisé subtilement) que nous connaissons déjà, cela pourrait offrir plus de possibilités dans le traitement du texte sans doute… là par exemple, en écrivant cela, je vois l’image d’un texte qui se brouillerait pour signifier l’incompréhension ou l’évanouissement, ou des bouts de texte qui disparaîtraient pour transformer un récit en un autre, d’une lecture à l’autre.
Aussi, si on lit sur smartphone on écrit aussi sur smartphone (c’est souvent le cas pour moi, tout Transport commun par exemple, No Future aussi qui était supposé sortir au Maroc en 2016 dans une merveilleuse maison marocaine qui a fait faillite, les éditions du Sirocco, (Coucou Karine Joseph, amour sur toi ! J’ai acheté un bracelet en or avec l’acompte que tu m’avais donnée. Merci)), cela rend l’écriture encore plus accessible à des personnes qui n’en ont pas le temps, l’énergie, la capacité physique ou psychologique, les moyens financiers, etc. et ouvre la voie à d’autres voix, complète la connaissance que nous avons du monde et de la vie, des réalités, en multipliant les accès. Chaque réalité a une esthétique particulière.
« Et moi / au milieu / puisque c’est moi qui écris », lit-on page 25. Je vois dans ces trois lignes, décalées les unes par rapport aux autres en haut de la page, toute la force de résistance que représente la parole pour vous. Parler, et donc écrire, est-ce résister ?
Oui.
Résister dans le sens garder la vie, comme une gardienne.
« Pour changer le monde ce qui est essentiel c’est le travail sur le langage parce que les mots nous trahissent perpétuellement, ils nous trahissent parce qu’ils ne veulent pas dire la même chose pour les gens de droite et les gens de gauche, pour les parents et les enfants. Le langage produit des malentendus perpétuels », dit Michel Butor dans un entretien [2]. Pensez-vous que le travail sur le langage peut changer le monde ?
Oui, en bien comme en mal. Ça dépend quel langage est glorifié à quelle époque. Qui travaille le langage et pourquoi. Qui veut posséder quoi et à quel prix.
Une fois passée la surprise de découvrir la suite de poèmes que vous avez composée sur l’épouse du 45ème Président des États-Unis d’Amérique intitulée « Sainte-Melania », on ne peut qu’être séduits par la beauté féroce de ce portrait de femme à la « sainteté de playmate ». Qu’est-ce qui vous a attiré dans le personnage de Melania Trump au point d’en faire une figure centrale de votre Transport commun ?
Tout en elle est fait pour attirer, mais n’attire pas forcement vers l’essentiel. C’est, c’était maintenant, la Première Dame de la plus grande puissance impérialiste au monde. Elle est blanche, très belle, intelligente, charismatique, élégante. Elle est supposée avoir un pouvoir immense et en fait, elle a autant de pouvoir qu’un moineau, sans en avoir la liberté. Elle se laisse dépouiller de toute la puissance de son érotisme qu’elle enferme dans sa tour quand elle ne le met pas au service de son mari et de la carrière de son mari.
Ce qui me frappe et m’angoisse chez elle, c’est ce que ça dit de l’être-femme dans notre monde : c’est terrifiant de voir que des personnages féminins peuvent être soumis et écrasés même au plus haut de la pyramide. De même que Penelope Clarke, épouse Fillon, qui est avocate de formation et qui se consacre à l’éducation de ses 5 enfants et sert de marchepied à son politicien de mari (comment peut-on accéder à un aussi haut poste que celui de Premier Ministre tout en étant père de 5 enfants, sans se décharger totalement sur l’autre ?) jusqu’à se retrouver au cœur de l’affaire de détournement de fonds que nous connaissons. Sur de nombreuses images, on voit même son mari la tenir par la nuque et la faire avancer au milieu de la foule des journalistes. Elle a parlé extrêmement peu dans une affaire qui la met en cause directement laissant son mari se charger de balayer les accusations, de mentir encore et encore. Cela dit, la différence entre Penelope et Melania, c’est que cette dernière a un feu intérieur terrible qui la maintient, cela se sent, lui fait repousser la main de son mari lors de certaines cérémonies comme on a pu le voir dans des gifs qui se veulent comiques mais qui sont un concentré dramatique. Ce qui n’est pas le cas de Penelope qui semble être à bout de souffle, les yeux encore bandés. La différence réside peut-être dans l’érotisme de l’une et la virginité totale et cucul de l’autre. Les deux femmes sont la vérité qui se cache derrière le « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».

Dans plusieurs poèmes, vous n’hésitez pas à citer des noms de marques de bière, de vêtements, de jeux, etc. Est-ce à dire que pour vous rien n’est indigne de figurer dans un poème ?
J’aime beaucoup les noms propres et plus généralement tout ce qui échappe au dictionnaire, qui n’a pas besoin d’y figurer pour qu’on le reconnaisse, pour avoir une définition et des contours clairs. Tout peut entrer dans un poème, absolument tout. Comme pour Melania Trump, Première Dame qui ne l’est plus, le poème parle de son temps, même si ce temps ne dure que 4 ans ou même 1 minute. Et quoi de mieux que les noms propres pour figurer une époque, situer ! Et puis certains sont des mots très beaux : le Rivolux qui était mon bar préf à Paris m’inspire des images de rêve et de révolution et de secret avec son x bien aiguisé et brutal (j’adore les noms de famille qui finissent par un x. J’ai une amie qui s’appelle Anna Ravix et je trouve cela merveilleux. Elle se retrouvera sans doute un jour dans un de mes textes) qui ferme bien, Guerrisol — qui est une chaîne d’habits de seconde main — le mot m’évoque soleil et guérison…
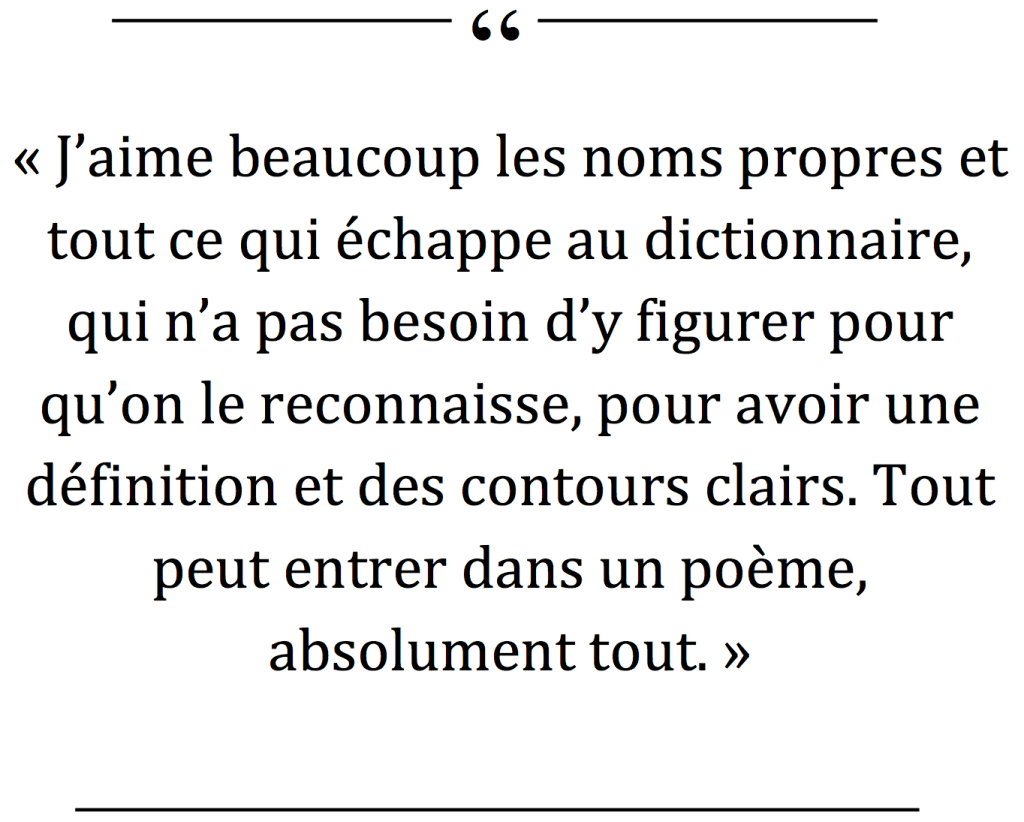
Le recueil se clôt sur un poème dans lequel se ressent l’influence de la poésie spatialiste que Pierre Garnier définissait comme débarrassée « des phrases, des mots, des articulations », « agrandie jusqu’au souffle ». Et pages 38-39 et 48 sont imprimés en très gros caractères gras des poèmes aussi courts que des slogans publicitaires, rappelant l’esthétique de John Giorno. S’agissait-il pour vous d’expérimenter plusieurs esthétiques afin de trouver votre propre voie/voix ?
Oh oui, ce n’est qu’en publiant qu’on sait ce qu’on veut écrire avec précision et de quelle façon. C’est un esprit d’escalier interminable qu’une carrière de poète. Comme je le dis plus haut, il faut s’autoriser à jouer, à s’amuser, essayer ce qui est à la mode ou ce qui ne l’est plus pour pouvoir se trouver. On chemine comme on peut. Ce sont aussi des formes qui se complètent, certaines sont destinées à être lues à haute voix, performées, d’autre à être regardées.
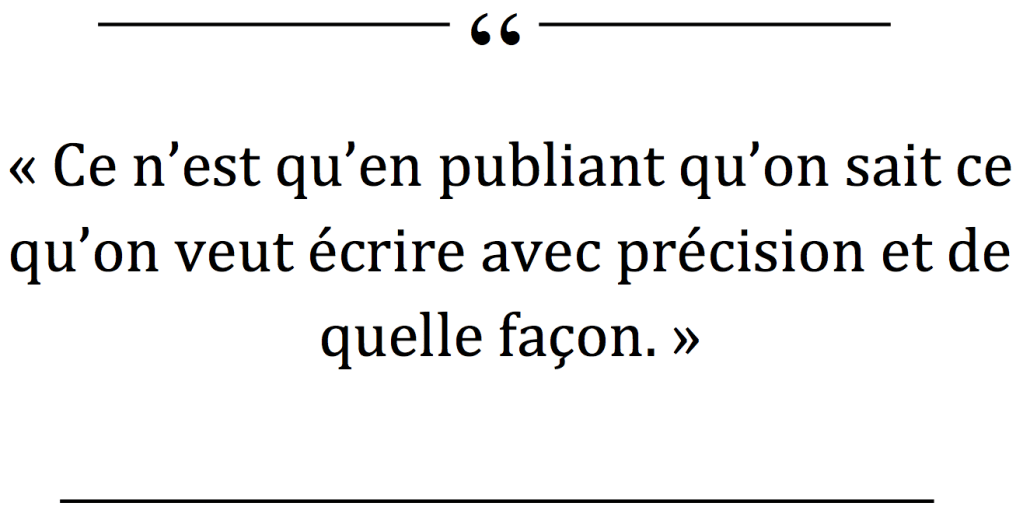
Dans mon prochain livre, il y a un poème sans mots hin hin hin
Oui, je ne fais que parler des Quatrains de l’all inclusive mais j’ai vraiment hâte qu’il sorte.
Quelles influences vous reconnaissez-vous ? Quels sont les artistes, poètes et poétesses dont les œuvres vont ont donné envie d’écrire ?
Bataille (ah oui, on peut être taré et écrire), Emily Brontë, Les Hauts de Hurle-Vent (ah oui, on peut écrire des personnages détestables et les rendre attachants), Balzac (ah oui, le tapis, les cuillères, les moisissures sur le banc : tout autour de moi est important), Tolstoï (voir depuis le corps souffrant, le corps qui se dégrade, le périssable (La mort d’Ivan Ilitch)), Céline et Despentes (ah oui, on peut utiliser le langage qu’on veut en fait, que ce soit un roman ou un essai), John Kennedy Toole (si je ne suis pas publiée, ne pas mourir tout de suite, on sait jamais), Cioran (être suicidaire c’est ne pas se suicider mais écrire. Se suicider, c’est juste mourir), Antonin Artaud (ah oui, on peut être taré et écrire bis), Dali (un imposteur n’est pas sans génie 😉 ), Rois et Reine de Desplechin (on peut faire cohabiter tous les arts dans n’importe quelle œuvre en fait), Joy Division, Timber timbre, Belle du Seigneur,… la liste est longue
Important : j’évoque ici mes early émotions littéraires et artistiques qui étaient tout de même assez convenues. Je lisais TOUT ce qui me tombait sous la main. Il n’y avait à l’époque, au Maroc et dans les villes où j’ai grandi, pas une librairie valable, pas une bibliothèque et c’était avant internet. J’ai regardé énormément de grands films VHS puis CD ou DVD piratés mais n’avais aucun moyen d’en savoir plus sur la réalisation, le processus créatif, etc. Je suis née à Casablanca mais j’ai grandi à Tantan, et sauf exceptions, mes profs de français confondaient les définitions de tentative et de tentation.
Et aussi, je parle ici de ce qui m’a donné envie d’écrire. Il y a plein de choses très belles que j’aime du fond du cœur mais qui ne m’ont pas donné envie d’écrire, qu’il m’a suffit de regarder ou lire. D’autres me donnent envie de chanter ou faire des films. Ou pratiquer des choses qui se pratiquent dans l’intimité ahaha
Par ailleurs, découvrir que Céline est antisémite m’a un peu dégoutée de son œuvre. On ne va pas épiloguer sur « séparer l’artiste de l’homme ». Chaque personne fait comme elle le sent, en son âme et conscience. Chez moi, ça se fait tout seul.
 Votre quatrième livre, L’Eau du bain paru en décembre 2019, me semble marquer une rupture dans votre œuvre [3]. Tout d’abord, il est édité chez Supernova et non plus chez LansKine, mais aussi, — bien que l’on retrouve plusieurs thèmes qui vous sont chers, ainsi que l’aspect autobiographique déjà très présent dans vos précédents livres —, la forme a changé : vous optez ici pour une forme de prose poétique. L’Eau du bain marque-t-il un tournant dans votre esthétique et dans votre parcours d’autrice ?
Votre quatrième livre, L’Eau du bain paru en décembre 2019, me semble marquer une rupture dans votre œuvre [3]. Tout d’abord, il est édité chez Supernova et non plus chez LansKine, mais aussi, — bien que l’on retrouve plusieurs thèmes qui vous sont chers, ainsi que l’aspect autobiographique déjà très présent dans vos précédents livres —, la forme a changé : vous optez ici pour une forme de prose poétique. L’Eau du bain marque-t-il un tournant dans votre esthétique et dans votre parcours d’autrice ?
Mes trois premiers livres ont vu le jour parce que j’essayais d’écrire de la poésie. L’Eau du bain a été écrit pour des questions de survie. J’ai vu la mort à plusieurs reprises en devenant mère pour la deuxième fois. Mes deux enfants ont seulement 18 mois d’écart et je n’ai pas la santé du mal. Mon corps comme le reste n’ont pas eu le temps de souffler — bien que les deux grossesses étaient voulues mais bon, avec la parentalité, on signe toujours à blanc, même pour le dixième gosse.

J’étais donc dans un tel état d’épuisement qu’il m’a semblé vital de planter des piolets sous forme de notes entre deux tétées, deux couches, deux évanouissements. Il a été écrit dans l’urgence, c’est donc cela son esthétique : l’urgence ! (trop de DRAMA cette réponse ahaha mais c’est la vérité. On lui doit de la dire.)
Les Quatrains de l’all inclusive qui sort en février 2021 est encore différent.
Dans l’un des textes de ce recueil, vous dites avoir choisi à vingt ans de vous appeler George. Était-ce en référence à George Sand ? Pourquoi ce pseudonyme ?
Alors à la base c’était en effet en référence à George Sand, oui. Puis en évoluant, en lisant mieux, le personnage de Sand ainsi que sa littérature m’ont semblé vraiment trop cucul pour correspondre à ce que je voulais faire de moi-même. Je voulais être un garçon. Je ne me retrouvais pas du tout dans la proposition « femme », ce que cela impliquait comme performance de soi, comme sacrifices, comme charge de travail, comme enfermement, comme mensonges, la violence, les injonctions permanentes, tout ça… ça m’apparaissait comme un mauvais usage à faire de l’unique vie que nous avons à mener. Vraiment, ce n’était pas du tout le bon plan ahaha. Et puis dès que je m’exprimais on me répondait « mais t’es un vrai mec toi ! ». J’étais aussi très émue par certaines jeunes filles de mon lycée… donc grosse confusion.
J’avais décidé que j’allais être un mec qui s’appelle George, pour effectuer aussi un pas de côté vis-à-vis de l’identité arabo-musulmane qu’on m’avait collée à la naissance et qui me semblait tronquée, partielle, politique, pour mieux la regarder et la décortiquer. J’ai compris ensuite mes origines rurales, berbères, un soupçon de juiveté chez une arrière-grand-mère, un grand-père noir, un autre avec des yeux bleus, etc.
Bref, avec George je voulais seulement être libre et j’avais l’impression que les garçons l’étaient plus que les filles. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. C’est un mauvais plan d’être un mec. Je le déconseille, d’ailleurs, au même titre que femme. Beurk.

« Pour devenir soi-même, il faut mourir à soi-même », dit Charles Juliet dans un entretien [4]. Écrit-on pour devenir soi-même, pour se libérer ?
Elles sont dures vos questions, je trouve… déjà qu’il faut se mettre à nu pour composer de la poésie ou créer quoi que ce soit de valable, mais là je fais quoi ? J’enlève ma peau ? Ahaha
Je ne sais pas si écrire libère. Je me sens plus libre depuis que j’écris mais j’ai mené aussi d’autres actions parallèles pour y parvenir : lire, partir de chez moi, loin de chez moi, ne plus regarder la « vie publique » que comme le spectacle qu’elle est, rire, faire le ménage, discuter avec des personnes bienveillantes, apprendre à repérer la bienveillance et la rechercher, la montrer, essayer de gagner un peu de sous, bien manger, réparer, soigner, etc. Je n’ai pas fait qu’écrire. Je ne peux donc pas isoler l’écriture et dire avec précision son effet libérateur ou pas.
Mais clairement pour devenir soi-même, il faut enterrer la fiction première de nous-même, faite d’éducation, projections et rêves des parents, identité de genre et de territoire, injonctions politiques et sociales, la gymnastique que l’on fait pour correspondre et ainsi survivre aux milieux premiers, aux premières étiquettes, etc. Et ça, c’est une grosse mort. Une bonne grosse mort. C’est pas rien de renoncer à tout cela : au regard de sa mère et aux rêves de sa mère. Et ce n’est pas tout.

« Nous vivons dans la terminologie alors qu’il faut vivre dans la blessure. Nous parlons de choses qui sont des slogans au lieu de ressentir la peine, la douleur. J’écris pour rendre à mon lecteur la douleur, le plaisir, le désir, la curiosité », confiait Amos Oz dans un entretien [5]. Vous qui vous dévoilez dans vos textes, livrant vos bonheurs, vos douleurs, vos plaisirs et vos désirs, pour qui écrivez-vous ?
Je n’ai jamais imaginé mon lecteur ou ma lectrice et suis donc toujours étonnée lorsque je les rencontre. J’écris pour toutes celles et tous ceux qui cherchent une amie, une semblable. (iels ne sont pas beaucoup visiblement, tout le monde est maqué ahaha enfin, je dis ça, mais on réédite Transport commun chez LansKine hehe)
Vous donnez des lectures publiques de vos œuvres. Pensez-vous à ces lectures à voix haute lorsque vous écrivez ?
Depuis le second livre, oui. En publiant le premier, je n’avais pas prévu de le lire, l’oraliser, le performer, etc. J’ai rapidement compris qu’il fallait porter un livre plus longtemps que le temps de l’écriture. Enfin, c’est Paul de Brancion qui m’avait dit ça et j’avais répondu « hors de question que je lise ! », il avait simplement dit « tu verras, c’est bien ». Après être passée par deux comédiennes pour des lectures publiques — gros traumatisme — j’ai décidé de me jeter à l’eau : on n’est jamais mieux servie que par soi-même, me dis-je alors. Or, j’ai découvert que mes premiers textes ne se prêtaient pas facilement à la lecture à haute voix. Pour la bleue que j’étais en tous cas. Maintenant j’y pense et je travaille mon texte en fonction et c’est un exercice à la fois exigeant et fort agréable. Et j’adore lire. Surtout en tête-à-tête.

À quoi ressemble votre table de travail ?
À Notes, sur mon iPhone ahaha
Un ordi avec des dossiers plus ou moins bien classés. À une flopée de carnets dans lesquels je prends des notes que je ne relis jamais mais que je garde dans un tiroir depuis plusieurs années.
J’écris dans les transports, dans la rue, à la plage, en soirée et je retravaille et corrige dans mon lit (ou dans « un lit ». C’est mon milieu naturel, le lit). On est loin du glamour des belles tables de travail de Brice Bonfanti ou des murs couverts d’épreuves d’Arno Bertina ahaha
Comment vient l’idée de départ d’une œuvre ? Est-ce qu’à l’origine il y a une idée, une image, un son ? Quelle est l’impulsion première ?
C’est une première phrase. Autour de laquelle se construit tout le reste.
Pour Latex par exemple, c’était « eat me I’m halal ». Vingt poèmes c’est « J’ai cassé ma tasse de café ce matin ». Transport commun c’est… je vous laisse deviner ahaha
Sans cette première phrase, impossible de mettre en forme les images qui se manifestent à moi, une nébuleuse d’idées qui flottent dans ma tête et me rend de mauvaise humeur lorsque je suis entourée par quoi que ce soit qui m’extirpe de là et m’éloigne de cette matière. J’ai été de très mauvaise compagnie pendant les 2 semaines de vacances en Sardaigne lorsque j’écrivais Les Quatrains. Et là je sors à peine d’une phase douloureuse pendant laquelle je n’arrivais pas à formuler quoi que ce soit pour des projets en cours, un roman que j’ai envie d’écrire. On est loin de cette première phrase encore mais je sens que ça vient.

Et cette première phrase vient en marchant, en écoutant de la musique ou la radio, en regardant un film, en soirée, en écoutant la radio, en regardant voler les mouches, en ayant mes douleurs de règles, en vernissant mes ongles, en étant en manque d’amour ou au contraire jaillissement d’un trop-plein d’amour…
Comment travaillez-vous ? Écrivez-vous un premier jet avant d’effectuer un travail de réécriture sur l’ensemble de votre texte ? Ou le corrigez-vous à mesure que vous l’écrivez ?
Premier jet, oui puis je réécris et réécris et réécris avant de faire lire à — en moyenne — 3 personnes au hasard et je réécris. Et généralement ce qui sort n’a plus rien à voir ni avec le premier jet ni avec ce qu’ont lu les personnes consultées. Et parfois, il ne sort rien. Je fais lire puis ça s’arrête là. Ça dort éternellement dans des fichiers électroniques.
Quand savez-vous que le livre est terminé et que votre texte est devenu un livre précisément ?
Ça dépend. Soit quand je me sens vraiment très fière du résultat (comme pour le prochain par exemple, Les Quatrains de l’all inclusive à paraître en février chez Le Castor Astral — ahaha ok j’arrête de parler de ce livre pour ne pas lui envoyer le mauvais œil), soit quand le travail de réécriture commence à m’écœurer (Latex chez LansKine et L’Eau du bain chez Supernova m’ont fait cet effet). Là, je me dis bon, j’ai fait le tour.
Est-ce que vous avez le sentiment d’avoir progressé dans votre écriture d’œuvre en œuvre ?
Complètement. Et avec l’immense tristesse qu’est la certitude d’être incapable aujourd’hui d’écrire comme avant. Je suis très heureuse de ma manière d’écrire aujourd’hui mais quand je relis Vingt poèmes et des poussières (LansKine, 2015) je sais que je ne saurais même pas me pasticher. Comme si c’était une autre qui l’avait écrit. C’est ça qui est horrible là-dedans : c’est avoir la preuve qu’on est mille personnes différentes sur une vie, sans changer vraiment.

Quel lien unit vos différentes créations, que ce soient vos photographies ou vos livres ? Avez-vous conscience de faire œuvre ?
Oui, mais je ne tiens pas encore ce lien avec précision et ne saurait en parler sans dire de bêtises. Mais plusieurs étudiantes en Licence et Master Littérature à la faculté de Lyon 3 — comme je le disais plus haut — ont travaillé sur le lien entre mes travaux photographiques et mes textes pour un cours de Photolittérature (avec Pr. Touriya Fili) et elles disent des choses beaucoup plus pertinentes que ce que je pourrais en dire moi-même. À ce stade en tous cas.
En mars 2019, vous étiez invitée à participer, avec trente écrivain.e.s, au « Libé des écrivains » emmené.e.s par Nicolas Mathieu, rédacteur en chef d’un jour et prix Goncourt 2018. Les Inrockuptibles consacraient le même mois un article aux « dix poètes nouvelle génération à suivre sur les réseaux sociaux » dont vous faites partie aux côtés de Cécile Coulon [6]. Avez-vous le sentiment d’appartenir à une même génération de poètes et de poétesses ?
Pas vraiment. Même si je comprends cette approche par génération en prenant en compte les influences, l’avancement des luttes, les moyens dont nous disposons pour écrire, travailler, diffuser, porter son travail, etc. Ça rend la scène de poésie plus « lisible ». Je comprends aussi l’importance d’avancer ensemble, se faire l’écho des autres sans forcément faire école ni mouvement. J’ai l’impression qu’on a aujourd’hui, avec les poètes de « ma génération » que j’ai pu rencontrer jusque-là, la même jubilation et le même sérieux dans notre manière d’appréhender la poésie comme un art et comme un métier. Je me sens proche en effet de Cécile Coulon mais aussi de Kenny Ozier-La Fontaine, de Séverine Daucourt, Emanuel Campo, Marguerin Le Louvier, dans ce qu’ils et elles essayent de faire de l’écriture. Je me sens proche aussi d’autres mais d’une autre façon, les connexions se font dans d’autres lieux, je me sens proche de Guillaume Marie mon ami dans la poésie, Laure Gauthier, Laura Vazquez, Maxime Paillassou ou encore Ariel Spiegler. J’aime d’amour Mon corps n’obéit plus de Thommerel publié chez Nous, Sonia Chiambretto, Antoine Mouton… Benoît Toqué et Pierre Vinclair, Marie de Quatrebarbes même si j’en suis loin dans mon écriture (j’arrête là sinon ça va devenir un name-dropping à la con).
 Votre prochain recueil paraîtra en 2021 chez Le Castor Astral. Pouvez-vous déjà nous dire quelques mots de ces Quatrains de l’all inclusive ?
Votre prochain recueil paraîtra en 2021 chez Le Castor Astral. Pouvez-vous déjà nous dire quelques mots de ces Quatrains de l’all inclusive ?
Il est génial.
Je crois que j’ai réussi à écrire ce que je rêvais de lire d’une femme de ma condition.
Entretien réalisé par courrier électronique en novembre 2020. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photo de l’autrice par Christophe Bourreau © Christof photography.
[1] À écouter, la lecture à voix haute d’extraits de Transport commun par Guillaume Richez : https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2020/05/28/transport-commun-de-rim-battal-audio/
[2] https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-entretien/le-grand-entretien-27-novembre-2012
[3] À lire, la note de lecture de L’Eau du bain par Pierre Troullier : https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2020/04/03/leau-du-bain-de-rim-battal-par-pierre-troullier/
[5] https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/amos-oz-2016
Entretien intéressant
Questions de Guillaume Richez fort pertinentes-
Béatrice Mauri
J’aimeAimé par 1 personne